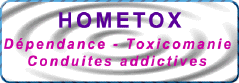|
CLINIQUE DES TOXICOMANIES
Sujet d�actualit�, la toxicomanie fait l�objet de
nombreux d�bats de soci�t�. L�impact psychologique au
niveau de l�imaginaire et des repr�sentations est immense.
La probl�matique de la d�pendance, la recherche du plaisir
ou les aspects archa�ques de cette probl�matique nous
renvoie � chacun d�entre nous diff�rentes images. La
meilleure connaissance des diff�rents aspects permet de mieux
se situer et de mieux appr�cier les diff�rents niveaux d�intervention,
qu�ils soient m�dicaux, socio-�ducatifs, judiciaire ou
politiques. Le danger de la banalisation excessive et/ou d�une
dramatisation parfois abusive existe, peut-�tre par manque d�informations
pertinentes, peut-�tre par peur de reconna�tre certaines
situations personnelles.
La
consommation de drogue sp�cifique � la toxicomanie
(existence d�une d�pendance biologique, psychologique et
sociale, le d�sir puissant, compulsif d�utiliser une
substance psychoactive, les difficult�s � en contr�ler les
prises, le comportement de recherche de ces substances avec un
envahissement progressif de la vie courante) doit �tre
diff�renci�e de l�usage occasionnel et de l�abus aux
cons�quences moindres ainsi que des d�pendances
m�dicamenteuses non toxicomaniaques caract�ris�es par l�absence
de recherche d�un effet stup�fiant.
Il
faut souligner l�aspect extensif et progressif vers la
chronicit� des troubles qui caract�risent la toxicomanie.
La
plupart des sp�cialistes s�accordent pour souligner le fait
que l�usage des drogues ne soit pas forcement une
toxicomanie. Aussi paradoxalement que puissent para�tre, il
ne faut pas oublier que le ph�nom�ne toxicomaniaque est le
r�sultat de plusieurs facteurs (individuels,
environnementaux, sociaux) : attrait du plaisir interdit,
fascination pour le danger potentiel (juridique, m�dical),
curiosit�, pression du groupe, facteur initiatique, recherche
des liens, rejet et rupture avec les valeurs traditionnelles,
esprit de provocation, recherche d�une autre r�alit� par
refus d�acceptation d�un monde jug� trop conventionnel,
recherche de sensations�
Du
point de vue psychopathologique, on est concern� par l��tude
d�un mode de consommation " inadapt� "
d�une substance psychoactive. On r�p�te que les trois
dimensions principales qui nous int�ressent sont la dimension
culturelle et sociale (acculturation, rapport avec les
probl�mes de la soci�t� et le recours aux substances
psychodysleptiques ou stimulantes), la dimension biologique
(propri�t�s intrins�ques du produit) et la dimension
psychologique (tentatives de r�solution d�un probl�me,
r�p�tition des sensations et recherche de plaisirs).
La grande
variété des substances psychoactives,
des individualités impliquées, de la
différence des situations et des cas
particuliers, on est en droit de parler des
toxicomanies et pas de la toxicomanie.
On
entend de plus en plus souvent le mot
" drogue ". Ce terme est li� � l�imaginaire
humain, � la mythologie, mais sans aucun lien �vident avec
la pharmacologie. La confusion est d�autant plus forte que
les Anglo-saxons d�signent par le terme drogue, les
m�dicaments et les substances psychoactives. De ce fait, � l�heure
actuelle on utilise le terme des " substances
psychoactives ", terme qui a l�avantage de
mieux d�finir une dimension importante de ces substances �
l�action au niveau du syst�me psychique. Les interf�rences
avec les neurom�diateurs (substances endog�nes intervenant
dans le fonctionnement du syst�me nerveux central et dans la
transmission des informations), expliquent en partie les
actions et les effets des substances psychoactives.
La
classification de ces substances à
préoccupé bon nombre de
pharmacologues, la plus ancienne étant celle
de Louis Lewin (1924) ; cette classification a
le mérite de faire pour la première
fois la distinction entre les actions des drogues.
Une classification plus récente est celle de
Delay et Denicker (1957), qui différencie
trois grandes familles de produits selon leur effet
principal sur le système nerveux central -
SNC :
 Substances
s�datives, qui inhibent et diminuent l�activit�
du SNC Substances
s�datives, qui inhibent et diminuent l�activit�
du SNC
 Substances
stimulantes, activatrices
et excitantes Substances
stimulantes, activatrices
et excitantes
 Substances
perturbatrices, Substances
perturbatrices,
On va utiliser
une autre classification, plus r�cente et qui reprend l�ancienne
classification de Dealy et Denicker.
CLASSIFICATION PRODUITS
PSYCHOTROPES
|
Excitants
- " uppers " :
 coca�ne,
crack. coca�ne,
crack.
 dexamph�tamines,
metamph�tamines, anorexig�nes. dexamph�tamines,
metamph�tamines, anorexig�nes.
 nicotine,
caf�ine. nicotine,
caf�ine.
Calmants
- " downers " :
 opio�des. opio�des.
 anxiolytiques/hypnotiques. anxiolytiques/hypnotiques.
 alcool. alcool.
Hallucinogènes
- " all
arounders " :
 type
indole - LSD, champignons, ibogaine, DMT... type
indole - LSD, champignons, ibogaine, DMT...
 type
ph�nylalcoylamine - mescaline, ecstasy. type
ph�nylalcoylamine - mescaline, ecstasy.
 anticholinergiques
- belladone, amanites, muscade. anticholinergiques
- belladone, amanites, muscade.
 PCP,
k�tamine. PCP,
k�tamine.
 cannabinols
- 9 THC , dronabinols. cannabinols
- 9 THC , dronabinols.
|
Retour
en haut de la page
La
n�cessit� d�une distinction des concepts comme l�usage,
l�abus et la d�pendance semble obligatoire. Les premiers l�avoir
r�alis�e sont les sp�cialistes am�ricains. Dans la
classification DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des
troubles mentaux), ces concepts trouvent une expression
scientifique, avec des crit�res convergents. La
classification de l�Organisation Mondiale de la Sant�, le
CIM 10 (Classification internationale des maladies), fait la
m�me distinction entre ces concepts.
CRITERS
DE LA DEPENDANCE SELON
DSM-IV
|
La
dépendance est un mode d�utilisation
inappropri� d�une substance, entra�nant une d�tresse ou
un dysfonctionnement cliniquement significatif, comme en
t�moignent trois (ou plus) des manifestations suivantes,
survenant � n�importe quel moment sur la m�me p�riode de
douze mois :
1.
tolérance, d�finie par l�une
ou l�autre des manifestations suivantes :
-
besoin
de quantit�s nettement major�es des la substance
pour obtenir une intoxication ou l�effet
d�sir� ;
-
effet
nettement diminu� en cas d�usage continu de la
m�me quantit� de substance.
2.
comme en t�moigne l�une ou l�autre des manifestations
suivantes :
-
syndrome
de sevrage caractéristique de la
substance ;
-
la
m�me substance (ou une substance apparent�e) est
prise dans le but de soulager ou d��viter les
sympt�mes de sevrage.
3.
substance souvent prise en
quantit� sup�rieure ou sur un laps de temps plus long que ce
que la personne avait envisag�
4.
d�sir persistant ou efforts infructueux pour r�duire
ou contr�ler l�utilisation de la substance ;
5.
temps consid�rable pass� � faire le n�cessaire
pour se procurer la substance, la consommer ou r�cup�rer de
ses effets ;
6.
d�importantes activit�s sociales, occupationnelles
ou de loisirs sont abandonn�es ou r�duites en raison de l�utilisation
de la substance ;
7.
poursuite de l�utilisation de la substance malgr�
la connaissance de l�existence d�un probl�me physique ou
psychologique persistant ou r�current d�termin� ou
exacerb� par la substance.
|
Préciser :
Avec dépendance
physique : signes de
tolérance ou de sevrage (item 1 ou 2
présents) ;
Sans dépendance
physique : pas de signes de
tolérance ou de sevrage (item 1 ou 2
absents).
Retour
en haut de la page
CRITERES DE LA DEPENDANCE DE L�ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE CIM-10 (1992)
Cette
classification est plus simple, mais de ce fait elle a le
m�rite d��tre plus facilement utilisable.
Certains sympt�mes du trouble ont persist� au moins un mois
ou sont survenus de fa�on r�p�t�e sur une p�riode
prolong�e.
Au moins trois des manifestations suivantes sont pr�sentes en
m�me temps au cours de la derni�re ann�e :
-
d�sir
puissant ou compulsif d�utiliser une substance
psychoactive ;
-
difficult�s
� contr�ler l�utilisation de la substance (d�but ou
interruption de la consommation au niveau de l�utilisation) ;
-
syndrome
de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arr�te
la consommation d�une substance psychoactive, comme en
t�moignent la survenue d�un syndrome de sevrage
caract�ristique de la substance, ou l�utilisation de la
m�me substance (ou d�une substance apparent�e) pour
soulager ou �viter les sympt�mes de sevrage ;
-
mise
en �vidence d�une tol�rance aux effets de la substance
psychoactive : le sujet a besoin d�une quantit�
plus importante de la substance pour obtenir l�effet
d�sir� ;
-
abandon
progressif d�autres sources de plaisir et d�int�r�t
au profit de l�utilisation de la substance psychoactive,
et augmentation du temps pass� � se procurer la
substance, la consommer ou r�cup�rer ses effets ;
-
poursuite
de la consommation de la substance malgré
la survenue de conséquences manifestement
nocives.
|
CRITERES DE L'ADDICTION SELON
GOODMAN (1990)
Goodman,
psychiatre anglais, a formul� en 1990 une d�finition de l�addiction
en la d�crivant comme "un processus dans lequel est
r�alis� un comportement qui peut avoir pour fonction de
procurer du plaisir et de soulager un malaise int�rieur, et
qui se caract�rise par l��chec r�p�t� de son contr�le
et sa persistance en d�pit des cons�quences
n�gatives". Il d�crit ainsi les crit�res d�inclusions
dans le champ des addictions :
|
A. Impossibilit�
de r�sister aux impulsions � r�aliser ce type de
comportement.
B. Sensation croissante
de tension pr�c�dant imm�diatement le d�but du
comportement.
C. Plaisir ou soulagement
pendant sa dur�e.
D. Sensation de perte de
contr�le pendant le comportement.
E. Pr�sence d�au moins cinq
des neuf crit�res suivants :
-
Préoccupation
fréquente au sujet du comportement ou
de sa préparation.
-
Intensit�
et dur�e des �pisodes plus importantes que
souhait�es � l�origine.
-
Tentatives
répétées pour
réduire, contrôler ou abandonner
le comportement.
-
Temps
important consacr� � pr�parer les �pisodes, � les
entreprendre ou � s�en remettre.
-
Survenue
fréquente des épisodes lorsque
le sujet doit accomplir des obligations
professionnelles, scolaires ou
universitaires, familiale ou
sociales.
-
Activités
sociales, professionnelles ou
récréatives majeures
sacrifiées du fait du
comportement.
-
Perp�tuation
du comportement, bien que le sujet sache qu�il cause
ou aggrave un probl�me persistant ou r�current d�ordre
social, financier, psychologique ou psychique.
-
Tol�rance
marqu�e: besoin d�augmenter l�intensit� ou la
fr�quence pour obtenir l�effet d�sir�, ou
diminution de l�effet procur� par un comportement
de m�me intensit�.
F.
Agitation ou irritabilit� en cas d�impossibilit� de s�adonner
au comportement.
|
Retour
en haut de la
page
Certains
�l�ments du syndrome ont dur� plus d�un mois ou se sont
r�p�t�s pendant une p�riode plus longue.
Les toxicomanes pr�sentent plus que les autres, une
personnalit� d�pendante des autres. Leur parcours familial,
scolaire et social met en �vidence des difficult�s
relationnelles, des situations frustrantes et des multiples
s�parations qui ont �t� toujours mal v�cues. Ces
s�parations ne sont jamais admises, la r�paration de ces
frustrations �tant constamment d�ficitaire.
CRITERES DIAGNOSTIQUES DE LA
PERSONNALITE DEPENDANTE
DSM IV
Besoin
g�n�ral et excessif d��tre pris en charge, qui conduit �
un comportement soumis et � une peur de la s�paration, qui
appara�t au d�but de l��ge adulte et est pr�sent dans
des contextes divers, comme en t�moignent au moins cinq des
manifestations suivantes :
-
le
sujet a du mal à prendre des
décisions dans la vie courante sans
être rassuré ou conseillé de
manière excessive par
autrui ;
-
a
besoin que d�autres assument les responsabilit�s dans
la plupart des domaines importants de sa vie ;
-
a du
mal à exprimer un désaccord avec
autrui de peur de perdre son soutien et son
approbation ;
-
a
du mal � initier des projets ou � faire des choses seul
(par manque de confiance n son propre jugement ou en ses
propres capacit�s plut�t que par manque de confiance
et/ou d��nergie) ;
-
cherche
� outrance � obtenir le soutien et l�appui d�autrui,
au point de faire volontairement des choses
d�sagr�ables ;
-
se
sent mal � l�aise ou impuissant quand il est seul par
crainte exag�r�e d��tre incapable de se
d�brouiller ;
-
lorsqu�une
relation proche se termine, cherche de mani�re urgente
une autre relation qui puisse assurer les soins et le
soutien dont il a besoin ;
-
est
pr�occup� de mani�re irr�aliste par la crainte d��tre
laiss� � se d�brouiller tout seul.
|
Retour
en haut de la page
L�abus
(DSM-IV) ou l�usage nocif (CIM 10), est
caract�ris� par une consommation susceptible d�induire des
dommages au niveau somatique, psychoaffectif et social. Cette
notion est d�autant plus importante, que plusieurs auteurs s�efforcent
� d�montrer que l�utilisation de certaines substances
psychoactives peut �tre parfaitement ma�trisable, en
fonction de la personnalit� des usagers, de leur degr� de
fragilit� psychique ; cette notion permet de souligner l�importance
des facteurs de personnalit� et de pr�ciser le r�le des
facteurs de risque et de vuln�rabilit� dans l�apparition
de la d�pendance.
CRITERES DE L�ABUS
SELON DSM-IV (1991)
-
L�abus
est un mode d�utilisation inad�quat d�une substance,
conduisant � une alt�ration du fonctionnement ou � une
souffrance cliniquement significative, et caract�ris�
par la pr�sence d�au moins une des manifestations
suivantes au cours d�une p�riode de douze mois :
-
Utilisation
r�p�t�e d�une substance conduisant � l�incapacit�
de remplir des obligations majeures au travail, � l��cole
ou � la maison (absences r�p�t�es ou mauvaises
performances au travail du fait de l�utilisation de
la substance, exclusion temporaires ou d�finitives de
l��cole, n�gligence des t�ches m�nag�res
courantes) ;
-
Utilisation
r�p�t�e d�une substance dans des situations o�
cela peut �tre physiquement dangereux (par exemple,
lors de la conduite d�un v�hicule) ;
-
Probl�mes
judiciaires r�p�t�s li�s � l�utilisation de la
substance (arrestations pour comportement anormal en
rapport avec l�utilisation de la substance) ;
-
Utilisation
de la substance malgr� des probl�mes interpersonnels
ou sociaux, persistants ou r�currents, caus�s ou
exacerb�s par les effets de la substance (disputes
avec le conjoint � propos des cons�quences de l�intoxication
chronique).
B. Les sympt�mes n�ont jamais
atteint, pour cette classe de substance, les crit�res de la
d�pendance � une substance.
|
Retour
en haut de la page
CRITERES DE L�UTILISATION
NOCIVE POUR LA SANTE SELON LE CIM
10 (1992)
Mode
de consommation d�une substance psychoactive qui est
pr�judiciable � la sant�. Les complications peuvent �tre
physiques ou psychiques.
Le diagnostic repose sur des preuves manifestes que l�utilisation
d�une ou de plusieurs substances a entra�n� des troubles
psychologiques ou physiques. Ce mode de consommation donne
souvent lieu � des critiques et a souvent des cons�quences
sociales n�gatives. La d�sapprobation par autrui ou par l�environnement
culturel, et les cons�quences sociales n�gatives ne
suffisent toutefois pas pour faire le diagnostic. On ne fait
pas ce diagnostic quand le sujet pr�sente un syndrome de
d�pendance, un trouble sp�cifique li� � l�utilisation d�alcool
ou d�autres substances psychoactives. L�abus de substances
psychoactives est caract�ris� par une consommation qui donne
lieu � des dommages dans les domaines somatiques,
psychoaffectifs ou sociaux, mais cette d�finition ne fait pas
r�f�rence au caract�re licite ou illicite des produits.
Retour
en haut de la page
La toxicomanie est marqu�e par la
d�pendance physique, psychologique et sociale.
Selon l�OMS la dépendance
se d�finit comme un �tat psychique et parfois physique,
r�sultant de l'interaction entre un organisme vivant et une
substance psychoactive caract�ris� par des r�actions
comportementales et autres, qui comportent toujours une
compulsion � prendre la substance de fa�on continue ou
p�riodique de fa�on � ressentir ses effets psychiques et
parfois �viter le sevrage. La d�pendance appara�t ainsi
comme le r�sultat des effets pharmacologiques des produits
psychoactives additifs et de l'interaction avec l'�quipement
neuro-biologique de l'organisme. En termes
comportementalistes, la d�pendance est la r�sultante du
renforcement positif (effets agr�ables de la prise de drogue)
plus le renforcement n�gatif (effets d�sagr�ables dus aux
manque) plus la tol�rance (ph�nom�nes adaptatifs qui
s'opposent aux effets des produits psychoactifs). La
tol�rance appara�t comme un �tat d'adaptation
pharmacologique n�cessitant l'augmentation des doses pour
obtenir les m�mes effets.
Les
différentes dépendances
(physique, psychique) et le
syndrome de sevrage pour chaque produit psychoactif
sont présentées
schématiquement dans les deux tableaux qui
suivent.
DIFFERENTS
TYPES DE DEPENDANCE
D�apr�s : Altman et al.
" The biological, social and clinical bases of drug
addiction " Psychopharmacology, 1996
|
|
Tol�rance
|
Sensibilisation
|
D�pendance
physique
|
D�pendance
psychique
|
|
Opiac�s
|
Aux
effets d�presseurs et aux renforcements positifs
|
Aux
effets stimulants locomoteurs et aux sympt�mes de
sevrage (persistance sur 6 mois)
|
Risque
de rechute maximum � J+1
|
Oui
|
|
Alcool
|
Aux
effets s�datifs, subjectifs, ataxiques et
hypoth�rmiques
|
Aux
effets stimulants locomoteurs et aux sympt�mes de
sevrage
|
Oui
|
O
|
|
Amph�tamines
|
Aux
effets subjectifs et cardio-vasculaires
|
Aux
effets stimulants locomoteurs (persistance sur 6 mois)
|
?
|
Oui
|
|
Coca�ne
|
Aux
effets subjectifs et cardio-vasculaires
|
Aux
effets stimulants locomoteurs (dur�e ind�termin�e)
|
?
(certains auteurs d�crivent pourtant un risque de
rechute � J+4)
|
Oui
|
|
LSD
|
Aux
effets subjectifs
|
Non
|
Non
|
Oui
|
|
Nicotine
|
Aux
effets d�presseurs locomoteurs, aux effets
�metisants et cardio-vasculaires
|
Aux
effets psychostimulants
|
Oui
|
Oui
|
|
Cannabis
|
Aux
effets cardiaques et psychiques, crois�e et
asym�triques avec l�alcool et la morphine
|
Non
|
Non
|
Oui
|
| |
|
Le
syndrome de sevrage physique
(apparition d'un syndrome clinique sp�cifique par l'arr�t
brutal d'une substance psychoactive, prise de fa�on continue
et prolong�e) se manifeste dans le cas des opiac�s
(situation la plus fr�quemment rencontr�e) 12 � 24 heures
apr�s la derni�re prise, d�butant par une anxi�t� vive
avec une insomnie tenace. Les douleurs associ�es (dorso-lombaires,
abdominales), les crames nocturnes, les mouvements anormaux
signent ce type de syndrome de sevrage. Le syndrome de sevrage
s�accompagne d�un syndrome amotivationnel qui associe
d�ficit de l�activit� avec asth�nie et apragmatisme,
d�ficit intellectuel avec ralentissement id�ique, d�ficit
thymique et affectif avec d�sint�r�t et manifestations
d�pressives. Si le syndrome de sevrage diminue et dispara�t
au bout d�une semaine, le syndrome amotivationnel, met
plusieurs semaines avant de diminuer.
La
d�pendance physique comprend aussi de puissantes compulsions
� consommer des toxiques, r�veill�es m�me apr�s quelques
mois d�abstinence par toute situation �vocatrice de l�intoxication
(proposition de toxique, passage dans certains lieux de
trafic).
La
d�pendance psychologique renvoie aux effets psychotropes
intrins�ques � chaque substance � euphorisants,
antid�presseurs, anxiolytiques.
La
d�pendance sociale est �vidente dans le sens ou le
toxicomanes a organis� toute sa vie relationnelle et sociale
pour et autour de la drogue.
Une
fois pr�sent�s les crit�res de l�abus et de l�usage
nocif, on peut analyser les recherches effectu�es par
Zuckerman dans les ann�es soixante, essaient d��tablir un
lien entre les ph�nom�nes d�activation psychique et la
recherche de sensations. Celle-ci correspond au besoin d�exp�riences
nouvelles, complexes et vari�es et � la volont� de prendre
des risques physiques et sociaux dans le but d�obtenir et de
maintenir un niveau optimal �lev� d�activation
c�r�brale.
La
recherche de sensations est en relation avec des facteurs de
personnalit�s li�s au changement, � la nouveaut� et l�inhabituel.
Le caract�re impr�visible des exp�riences, la prise �lev�
de risque, met en jeu l�impulsivit� des sujets, qui �
travers ces situations obtiennent un niveau optimum d�excitation.
Retour en haut de la page
L��chelle
de recherche de sensations, - Sensation
Seeker Scale - (SSS), comporte quatre
facteurs qui d�finissent ce ph�nom�ne :
L�ECHELLE
DE RECHERCHE DE SENSATIONS
-
recherche
de danger/aventure - attrait pour les sports
et les conduites � risques, impliquant
vitesse et danger.
-
recherche
d�exp�rience - attrait pour des activit�s
intellectuelles ou sensorielles.
-
d�sinhibition
- attrait pour la boisson, l�alcool, les
exc�s sexuels.
-
susceptibilit�
� l�ennui.
Les
personnes qui pr�sentent un score �lev�, sont fr�quemment
retrouv�es parmi les grands pharmacod�pendants, les grands
consommateurs d�alcool, les grands fumeurs, les auteurs des
conduites � risques. Ils sont d�crits comme des personnes
extraverties en recherche permanente de facteurs stimulants.
Ils sont � la recherche de nouveaux partenaires, aussi
non-conformistes et aussi expos� aux risques qu�eux. Leur
aspect antisocial est le r�sultat de leur mode de vie et
activit�s, qui tendent � satisfaire sans arr�t leur
pulsion. Les conventions sociales, la loi, sont souvent
transgresser afin d�obtenir l��tat d�excitation � tout
prix.
Les
personnes qui ont un score �lev�, vivent d�une mani�re
risqu�e, pratiquent le plus souvent des activit�s sportives
tr�s physiques (plong�e, saut en parachute, escalade, saut
� l��lastique), jouent de mani�re compulsive, sans
contr�le et notion de risque. La prise de drogue appara�t
comme une tentative � ressentir de nouvelles sensations, de
passer � c�t� de la mort (l�ordalie), de se frotter au
divin et l�au-del�. Les pratiques sexuelles rev�tent
toujours d�une prise de risque (contacts non-prot�g�s,
plusieurs partenaires). Leur complexit� cognitive, la
tendance de recherche de nouvelles sources de connaissance et
de savoir, exposent ces personnes au merci des th�ories
pseudo-scientifiques, aux mouvements pr�nant la d�couverte
de soi (les sectes en occurrence).
Il
existe une relation �troite - mais non-sp�cifique et
non-exclusive - entre addictions et recherche de sensations.
Il faut retenir que l��chelle de sensations aide �
d�terminer un certain type de trouble comportemental, mais le
fait d�avoir un score �lev�, n�est pas un indice de
maladie mentale en lui-m�me. La corr�lation entre niveau
�lev� de la stimulation et le syst�me de r�compense
dopaminergique est tr�s forte.
Dans
le comportement addictif il existe deux p�riodes : la
phase d�initiation est centr�e sur la recherche de
sensations jouant un r�le essentiel dans la rencontre du
produit. L�installation de la d�pendance se produit plus
tardivement, quand l�usage du produit se poursuit sous
l'influence des exigences adaptatives li�es � l�anxi�t�
et au sevrage.
Retour
en haut de la page
Plusieurs
types de personnalit�s font partie de celles rencontr�es
souvent chez les toxicomanes. La caract�ristique antisociale
(le non-respect des r�gles, les tendances r�p�titives �
transgresser la loi) de la personne d�pendante ou le
caract�re obsessionnel, compulsif, �chappant � toute
tentative de (auto)contr�le n�cessite l�analyse des
crit�res typiques e ces personnalit�s.
CRITERES
DIAGNOSTIQUES DE LA PERSONNALITE ANTISOCIALE
DSM IV
|
A.
Mode g�n�ral de m�pris et de
transgression des droits d�autrui qui surviennent depuis l��ge
de15 ans, comme en t�moignent au moins trois des
manifestations suivantes :
-
incapacit�
de se conformer aux normes sociales qui d�terminent les
comportements l�gaux, comme l�indique la r�p�tition
de comportements passibles d�arrestation ;
-
tendance
� tromper par profit ou par plaisir, indiqu�e par
mensonges r�p�t�s, l�utilisation de pseudonymes ou
des escroquerie ;
-
impulsivit�
ou incapacit� � planifier � l�avance ;
-
irritabilit�
ou agressivit�, indiqu�e par la r�p�tition des
bagarres ou d�agressions ;
-
m�pris
inconsid�r� pour sa s�curit� ou celle d�autrui ;
-
irresponsabilit�
persistante, indiqu�e par l�incapacit� d�assumer un
emploi stable ou d�honorer des obligations
financi�res ;
-
absence
de remords, indiqu�e par le fait d��tre indiff�rent
ou de se justifier apr�s avoir bless�, maltrait� ou
vol� autrui ;
B.
Age au moins �gal � 18
ans ;
C. Manifestation d�un trouble des conduites avant
l��ge de 15 ans ;
D. Les comportements antisociaux ne surviennent
pas exclusivement pendant l��volution d�une
schizophr�nie ou d�un �pisode maniaque.
|
Retour
en haut de la page
PERSONALITE OBSESIONNELLE
Elle
se voit plus souvent chez l'homme que chez la femme. On en
distingue deux :
 La
personnalit� obsessionnelle avec caract�re anal :
faite de trois traits caract�ristiques : l'ordre,
l'�conomie, l'ent�tement. Go�t pour un ordre
excessif, aussi bien dans le domaine mat�riel que
dans le domaine moral. Conscience professionnelle,
perfectionnisme, attachement aux r�gles, aux plans
d'organisation. L'�conomie va confiner � la
mesquinerie et � l'avarice. Le go�t de la
propri�t� d�bouche sur le collectionnisme.
L'ent�tement : les obsessionnels sont des sujet
obstin�s, autoritaires, exigeant la soumission des
autres. Les sentiments sont peu exprim�s et mis �
distance. Les d�tails sont privil�gi�s par rapport
� l'ensemble. L'adaptation socioprofessionnelle est
souvent bonne, mais les relations sociales
difficiles. La
personnalit� obsessionnelle avec caract�re anal :
faite de trois traits caract�ristiques : l'ordre,
l'�conomie, l'ent�tement. Go�t pour un ordre
excessif, aussi bien dans le domaine mat�riel que
dans le domaine moral. Conscience professionnelle,
perfectionnisme, attachement aux r�gles, aux plans
d'organisation. L'�conomie va confiner � la
mesquinerie et � l'avarice. Le go�t de la
propri�t� d�bouche sur le collectionnisme.
L'ent�tement : les obsessionnels sont des sujet
obstin�s, autoritaires, exigeant la soumission des
autres. Les sentiments sont peu exprim�s et mis �
distance. Les d�tails sont privil�gi�s par rapport
� l'ensemble. L'adaptation socioprofessionnelle est
souvent bonne, mais les relations sociales
difficiles.
 La
personnalit� psychasth�nique : ce sont des
personnes qui ont des difficult�s � r�aliser des
activit�s intellectuelles de haut niveau, car elles
n�cessitent un effort p�niblement ressenti.
L'action est marqu�e par l'impuissance � agir, une
hyposexualit� ; le sujet � de la peine � prendre
des d�cisions, il s'int�gre mal � la r�alit�, a
tendance � r�ver et se sent � la limite de la
d�personnalisation. Par contre, les activit�s
psychiques de bas niveau (tendance aux scrupules, au
doute, aux ruminations mentales, � l'introspection
triste) vont �tre tr�s d�velopp�es. Le sujet se
r�fugie dans le perfectionnisme, il est lent,
m�ticuleux, moraliste, fatigu� le plus souvent
notamment le matin. L'adaptation socioprofessionnelle
est m�diocre en raison des r�veries et de
l'introspection, ainsi que des difficult�s dans
l'action et dans les d�cisions. Les complications
peuvent �tre l'apparition d'une n�vrose
obsessionnelle structur�e et, beaucoup plus souvent,
des �tats d�pressifs ou des d�compensations
psychosomatiques. Le traitement est difficile, ces
patients m�ritent d'�tre �cout�s, mais leur
lenteur font perdre beaucoup de temps. Il faudra
savoir leur prescrire des anti-asth�niques,
am�nager des p�riodes de repos, voire de cure
thermale. La
personnalit� psychasth�nique : ce sont des
personnes qui ont des difficult�s � r�aliser des
activit�s intellectuelles de haut niveau, car elles
n�cessitent un effort p�niblement ressenti.
L'action est marqu�e par l'impuissance � agir, une
hyposexualit� ; le sujet � de la peine � prendre
des d�cisions, il s'int�gre mal � la r�alit�, a
tendance � r�ver et se sent � la limite de la
d�personnalisation. Par contre, les activit�s
psychiques de bas niveau (tendance aux scrupules, au
doute, aux ruminations mentales, � l'introspection
triste) vont �tre tr�s d�velopp�es. Le sujet se
r�fugie dans le perfectionnisme, il est lent,
m�ticuleux, moraliste, fatigu� le plus souvent
notamment le matin. L'adaptation socioprofessionnelle
est m�diocre en raison des r�veries et de
l'introspection, ainsi que des difficult�s dans
l'action et dans les d�cisions. Les complications
peuvent �tre l'apparition d'une n�vrose
obsessionnelle structur�e et, beaucoup plus souvent,
des �tats d�pressifs ou des d�compensations
psychosomatiques. Le traitement est difficile, ces
patients m�ritent d'�tre �cout�s, mais leur
lenteur font perdre beaucoup de temps. Il faudra
savoir leur prescrire des anti-asth�niques,
am�nager des p�riodes de repos, voire de cure
thermale.
Il s'agit d'un mode g�n�ral de
pr�occupation par l'ordre, le perfectionnisme et le contr�le
mental et interpersonnel, aux d�pens d'une souplesse, d'une
ouverture et de l'efficacit� qui appara�t au d�but de
l'�ge adulte et est pr�sent dans des contextes divers, comme
en t�moignent au moins quatre des manifestations suivantes :
-
pr�occupations
par les d�tails, les r�gles, les inventaires,
l'organisation ou les plans au point que le but principal
de l'activit� est perdu de vue
2. perfectionnisme qui entrave l'ach�vement des t�ches
(p. ex., incapacit� d'achever un projet parce que des
exigences personnelles trop strictes ne sont pas
remplies) ;
-
d�votion
excessive pour le travail et la productivit� �
l'exclusion des loisirs et des amiti�s (sans que cela
soit expliqu� par des imp�ratifs �conomiques
�vidents) ;
-
est
trop consciencieux, scrupuleux et rigide sur des questions
de morale, d'�thique ou de valeurs (sans que cela soit
expliqu� par une appartenance religieuse ou
culturelle) ;
-
incapacit�
de jeter des objets us�s ou sans utilit� m�me si
ceux-ci n'ont pas de valeur sentimentale ;
-
r�ticence
� d�l�guer des t�ches ou � travailler avec autrui �
moins que les autres se soumettent exactement � sa
mani�re de faire les choses ;
-
se
montre avare avec l'argent pour soi-m�me et les autres;
l'argent est per�u comme quelques chose qui doit �tre
th�sauris� en vue de catastrophes futures ;
-
se
montre rigide
Retour
en haut de la page
Chez les patients pr�sentant une pathologie addictive, la
pr�valence des troubles mentaux est grande. Parmi les
pathologies rencontr�es on retient les troubles de l�humeur,
de la personnalit� et des troubles d�pressifs.
Les troubles dépressifs,
accompagnent souvent le parcours des toxicomanes ;
troubles pr�existants � la toxicomanie ou troubles qui
apparaissent pendant la consommation ou apr�s l�arr�t de
la consommation du produit. Le v�cu d�pressif des patients
les poussent souvent aux suicides ou des conduites � risque.
Parmi les m�canismes incrimin�s dans l�apparition des
troubles d�pressifs on d�c�le les interf�rences
biochimiques entre les neurom�diateurs impliqu�s dans
le processus addictif et les substances psychoactives.
Les
troubles anxieux, se manifestent le plus souvent dans
les phases d�abstinence ou pendant les cures de
sevrage ; tr�s fr�quentes dans le cas des opiac�s et
de l�alcool, ces troubles apparaissent aussi dans le cas des
autres substances. Le recours abusif ou la prescription
massive des anxiolytiques � surtout les benzodiaz�pines �
a comme cons�quence une d�viation de l�utilisation
th�rapeutique des benzodiaz�pines. La plupart des
toxicomanes ont souvent recours aux benzodiaz�pines afin de
palier les �tats de manque et les crises d�anxi�t� ;
dans les phases de descente, souvent p�nibles et difficiles
� supporter les toxicomanes font appel aux anxiolytiques. L�usage
d�tourn� des benzodiaz�pines - Tranx�ne, Rohypnol �
n�cessite une grande vigilance de la part des prescripteurs.
Chez certains h�ro�nomanes, l�h�ro�ne repr�sente une
tentative d�autom�dication. En fin, la pr�valence des troubles
obsessifs-compulsionnels, reste souvent sous-estim�e.
Les
états confusionnels sont favoris�s par les
polytoxicomanies et/ou par la brutalit� du sevrage. Les
patients sont souvent d�sorient�s temporo-spatial,
obnubil�s. Il ne faut pas occulter qu�en dehors de la
toxicologie intrins�que des substances psychoactives, les
�tats confusionnels peuvent �tre imput�s aux �tats
post-traumatiques ou post-infectieux (diff�rents abc�s,
forme neurologique du SIDA).
Les
états psychotiques, soul�vent la question de l�interaction
entre un toxicomane et une substance psychoactive. Le tableau
clinique prend la forme des troubles dissociatifs �
schizophr�nie � ou de d�lire chronique. On le r�p�te, il
faut faire la diff�rence entre les �tats pr�psychotiques
accentu�s par la prise de la substance psychoactive et les
pharmacopsychoses induites par la prise de ces m�mes
substances. Les schizophr�nes ont une attirance prononc�e
pour les drogues dysleptiques � cannabis ou LSD � qui
favorisent l�introspection. Pour cette cat�gorie de patient
l�abus de substances psychoactives peut s�inscrire dans
une d�marche d�autom�dication, de traitement des angoisses
et de l�anh�donie psychotique. Certains schizophr�nes
pr�f�rent �tre soign�s comme toxicomanes plut�t qu�au
titre de la psychose.
|