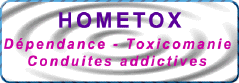|
Le
jeu pathologique
Dr
Marc Valleur
Psychiatre-addictologue
Chef
de Service
Centre
m�dical Marmottan
17/19
rue d'Armaill�
75017
Paris
(d�apr�s
� Le jeu pathologique �, (PUF, 1997), paru in revue � Toxibase �)
Introduction
Tant
aux niveaux des d�finitions ou mod�les explicatifs, que des propositions
d�action th�rapeutique ou pr�ventive, il n�existe actuellement pas
de consensus en mati�re de jeu pathologique.
Il ne s�agit pas ici d�une simple opposition entre des �coles diff�rentes
de techniciens du psychisme, qui d�battraient du meilleur moyen de
comprendre et de soigner une maladie ou un sympt�me. (Les psychanalystes
qui s�opposeraient aux comportementalistes, aux syst�mistes, aux
biologistes�)
La fronti�re est plut�t entre une conception sp�cifique, tendant �
faire du jeu pathologique une entit�, une forme pathologique en soi, et
d�autre part un abord de ce probl�me comme simple artefact, labile, et
sans grand int�r�t, du jeu en soi.
-
D�un
c�t�, se trouvent des sp�cialistes qui voient dans le jeu
pathologique une maladie, et qui vont en chercher les d�terminants
psychologiques, biologiques, neurophysiologiques, voire g�n�tiques.
Ces recherches visent � mettre au point des strat�gies th�rapeutiques,
domaine dans lequel il n�y a gu�re d�accord, comme en t�moigne
la gamme tr�s large des propositions. Nombre
d�auteurs admettent qu�il y aurait un lien entre ce �mod�le de
maladie�, et la promotion de l�abstinence totale et d�finitive
comme seul but de traitement. Ajoutons
qu�� l��vidence, il se trouvera plus, parmi les tenants de ce
mod�le, de personnes pr�tes � consid�rer le jeu pathologique comme
un fl�au social, et � donner des jeux d�argent et de hasard en g�n�ral
une image n�gative. Luttant
contre une maladie, les m�decins relaient en quelque sorte les pr�tres,
qui avaient lutt� contre le p�ch�, et longtemps soutenu les
interdictions l�gales en mati�re de jeu.
-
A
l�oppos�, les probl�mes des joueurs vont �tre abord�s de fa�on
sociologique, anthropologique, et seront per�us comme l�extr�mit�
d�une courbe de Gauss : il est admis de nos jours que la majorit�
de la population joue r�guli�rement aux jeux de hasard. Il est
normal que d�un c�t�, � une extr�mit� de la courbe, se trouve
une minorit� d�abstinents, primaires (ceux qui n�ont jamais jou�),
ou secondaires (ceux qui ont arr�t�). De l�autre c�t� se
retrouvera une autre minorit�, celle des personnes qui jouent plus
que les autres, qui jouent trop.
Dans
cette optique, il y a donc un continuum sans faille, dans les probl�mes
de jeu, tant dans les comparaisons que l�on peut faire entre telle ou
telle personne, que pour un individu donn�, dont la conduite de jeu
pourra varier avec le temps, se d�placer le long de ce continuum, du non
probl�matique au plus probl�matique.
Il
n�y aurait alors pas forc�ment � chercher un �traitement�, pour
une maladie inexistante, mais simplement � promouvoir des strat�gies
d�apprentissage et de contr�le, de promotion du jeu mod�r�.
Ces
oppositions de regard ne font que reproduire et transposer dans les m�mes
termes les diff�rents discours qui s�opposent, depuis des d�cennies,
en mati�re de toxicomanies, d�alcoolisme ou de tabagisme :
La
place singuli�re du jeu, longtemps consid�r� comme sacril�ge, puis l�galis�,
et aujourd�hui largement r�pandu, encourag�, dans tous les pays, en
fait un champ particuli�rement �clairant pour l�ensemble des
�nouvelles addictions�.
Il
existe des arguments tr�s forts en faveur de l�inclusion du jeu
pathologique dans cette notion d�addictions au sens large, qui d�passe
la d�pendance aux substances psychoactives pour s'�tendre aux
"addictions comportementales" (les
toxicomanies sans drogue).
-
Tout
d�abord la parent� entre les divers troubles qui s�y trouvent
regroup�s, et qui sont d�finis par la r�p�tition d�une conduite,
suppos�e par le sujet pr�visible, ma�trisable, s�opposant �
l�incertitude des rapports de d�sir, ou simplement existentiels,
interhumains.
-
Ensuite,
l�importance des �recoupements� (�overlaps�) entre les
diverses addictions : il existe une impotante pr�valence de
l�alcoolisme, du tabagisme, des toxicomanies, voire des troubles des
conduites alimentaires, chez les joueurs pathologiques.
-
Aussi,
la fr�quence r�guli�rement not�e de passages d�une addiction �
une autre, un toxicomane pouvant par exemple devenir alcoolique, puis
joueur, puis acheteur compulsif�
Enfin, la parent� dans les probl�matiques et les propositions th�rapeutiques.
Particuli�rement importante est ici l�existence des groupes
d�entraide, bas�s sur les �traitements en douze �tapes�, de
type Alcooliques Anonymes. Ce sont en effet exactement les m�mes
principes de traitements de conversion et de r�demption morale qui
sont propos�s aux alcooliques, aux toxicomanes, aux joueurs, et
accept�s par nombre d�entre eux.
Ces
mouvement d�entraide, qui recourent � un concept tr�s m�taphorique de
maladie, soulignent la dimension de souffrance personnelle, de sentiment
subjectif d�ali�nation des sujets, des joueurs pathologiques, qui,
comme les alcooliques ou les toxicomanes, ont l�impression d��tre la
proie d�un processus qui leur �chappe. Subjectivement en tout cas, il
n�y a pas continuit�, mais rupture, saut qualitatif, entre joueur et
joueur �pathologique�, comme entre usager de drogues et toxicomane.
Le lib�ralisme, le droit � disposer de soi-m�me, la promotion
d�approches visant � l�auto-contr�le, et non � l�abstinence, ne
doivent pas devenir le moyen de nier la souffrance de ceux qui en viennent
� �toucher le fond�, et � leur refuser les moyens de �s�en
sortir�.
Afin
d�aider la minorit� qui souffre de sa d�pendance au jeu, et de mieux
�tudier un ph�nom�ne encore trop opaque, il serait sans doute pr�f�rable
qu�une part des revenus du jeu soit utilis�e aux recherches, � la pr�vention
et au traitement du jeu pathologique.
Ceci permettrait de soutenir des traitements ou des actions pr�ventives
visant la pratique du jeu contr�l�. Et permettrait d�ancrer certaines
recherches sur l��tude des fonctions sociales et individuelles du jeu
�normal�. Le versant social et culturel, les d�terminants
anthropologiques, historiques, du jeu pathologique , seraient mieux �tudi�s
: les recherches en la mati�re ne porteraient pas simplement sur les
neurom�diateurs et la physiologie c�r�brale�
Le jeu pourrait alors pleinement devenir un mod�le dans le traitement par
la soci�t� de ces nouvelles entit�s morbides, les addictions, qui sont
encore trop souvent trait�es � la fois comme vice, crime, inf�riorit�
ou maladie. La d�prohibition, m�me pour certaines drogues, pourrait
appara�tre comme un objectif plus r�aliste, s�il existait la certitude
qu�elle ne serait pas une simple loi lib�rale destin�e aux plus forts,
abandonnant � leur sort ceux qui tombent dans le pi�ge de la d�pendance.
Retour
en haut de la page
Le
jeu dans la soci�t�
En
dehors du jeu chez l'enfant, les pratiques ludiques occupent une place
importante dans la vie des adultes, comme dans la marche de la soci�t�.
Le
jeu est, selon Huizinga, une action "d�nu�e de tout int�r�t mat�riel
et de toute utilit�" : il
s'int�resse avant tout aux formes de jeu qui impliquent une forme de comp�tition
entre les joueurs, excluant de son �tude les jeux d'argent.
Ce dernier point am�nera R. Caillois � proposer certaines modifications
dans la d�finition m�me du jeu. Selon lui, le jeu est une activit� :
-
Libre
et volontaire, source de joie et d'amusement : notons, pour notre
propos, l'importance de la formule ; "un jeu auquel on se
trouverait oblig� de participer cesserait aussit�t d'�tre un
jeu"�
-
S�par�e,
soigneusement isol�e du reste de l'existence, et accomplie en g�n�ral
dans des limites pr�cises de temps et de lieu.
-
Incertaine.
-
Comportant
des r�gles pr�cises,
arbitraires, irr�cusables.. (dans les jeux fictifs, non r�gl�s,
le "comme si" tient lieu de r�gle)
-
Fictive
: accompagn�e d'une conscience sp�cifique de r�alit� seconde�(Jeu
fictif et jeu r�gl� sont en quelque sorte deux cat�gories qui
s'excluent mutuellement.)
-
Improductive
: ce caract�re tient compte de l'existence des enjeux, des
paris, des pronostics, bref des jeux de hasard et d'argent.
Si
certaine des positions de Caillois peuvent aujourd'hui �tre discut�es,
c�est avant tout du fait de l��volution de la soci�t�. Sur le fond,
ses distinctions restent ind�niablement valides.
R.
Caillois propose une classification des jeux, qui est aujourd'hui bien
connue et utilis�e dans tous les secteurs de la connaissance concern�s
par la notion de jeu :
-
L'agon
est le champ des jeux de comp�tition, qui faisait l'essentiel
des analyses de Huizinga.
La mimicry celui des jeux de
r�les, d'imitation�
-
L'ilinx
regroupe les jeux de vertige, de sensation pure.
-
L'alea
est le champ qui nous int�resse particuli�rement : c'est
celui des jeux de hasard, parmi lesquels se trouveront les jeux
d'argent.
Retour
en haut de la page
Les
lieux et les instruments du jeu
Par
d�finition, dans les jeux de hasard et d'argent, ceux qui sont � la base
du jeu pathologique, l'argent est la mise, l'enjeu, les instruments sont
des m�canismes � produire du hasard, c'est-�-dire � donner un r�sultat
ind�pendant de l'habilet� du joueur. Ces instruments sont tr�s divers,
mais en fait, rel�vent de quelques cat�gories fort simples.
-
Les d�s : sont d�riv�s
des osselets, os du carpe de moutons, qui pr�sentent deux faces
larges et des bords �troits. La forme la plus simple de "machine
� hasard" est toujours une pi�ce � deux faces, le "pile
ou face" �tant un jeu o� les probalit�s sont de 50% pour
chaque �ventualit�.
-
Les cartes furent
introduites en occident au XIVeme
si�cle, par les Arabes, mais sont d'origine chinoise, et purent se r�pandre
en Europe � partir de l'invention de l'imprimerie.
-
Les grilles ou tableaux peuvent �tre rapproch�s des marelles, avec
leur lien � une repr�sentation sacr�e de l'univers.
-
Les machines � sous, invent�es aux �tats-Unis � la fin du si�cle
dernier, constituent la version la plus actuelle et la plus r�pandue
des machines � produire du hasard.
Retour
en haut de la page
Les
lieux du jeu
Sont
aussi tr�s divers, mais correspondent � deux grands groupes : les lieux
organis�s, et r�sev�s � cet usage, et les lieux priv�s...
Repr�sente
la forme embl�matique de la premi�re cat�gorie. Ils tendent de plus en
plus � s'adjoindre des lieux plus accessibles, moins "�litistes",
et surtout plus rentables, ouverts au plus grand nombre, sous la forme de
grandes salles r�serv�es aux machines � sous...
Sont
aussi des lieux r�serv�s au culte du jeu et � celui du cheval. Les
paris sur les courses de chevaux, organis�s par le P.M.U, peuvent aussi
se faire en suivant le tierc� du dimanche devant son �cran de t�l�vision,
et parmi les des bars, tabacs, PMU (qui permettent d�augmenter le nombre
de parieurs ) se trouvent les "courses par course", o� l'on
peut parier en temps r�el au fur et � mesure du d�roulement des �preuves...
Ce
sont en principe des lieux priv�s, organis�s en associations...
Les
points de vente du P.M.U et de la Fran�aise des Jeux sont en fait tr�s r�pandus,
et, comme il est possible d'y jouer aux courses, certains "jeux
d'impulsion", sous la forme de cartes � gratter au r�sultat
instantan�, ne font que reproduire les symboles et le principe des
machines � sous�
Le
premier �casino virtuel� a �t� ouvert sur Internet en ao�t 1995,
accueillant chaque mois plus de 7 millions de visiteurs sur le site
�Internet Casinos� : c'est devant son �cran que tout un chacun pourra
bient�t s'adonner au jeu...
Retour
en haut de la page
Aspects
�conomiques
Le
jeu occupe d�sormais une place importante � la fois dans l�activit�
d�une partie majoritaire de la population, et dans l��conomie.
En France, les chiffres d�affaires des �tablissements de jeu montrent
qu�ils sont source de revenus importants, d�emplois, mais aussi bien s�r
de pr�l�vements de l�Etat.
-
Les
casinos, s�ils ne sont plus les lieux des conduites extr�mes du
joueur de Dosto�evski, tirent maintenent la majorit� de leurs
ressources de l�exploitation des machines � sous : plus de 80% de
leurs revenus proviendrait de ces �bandits manchots�. M�me ici
donc, le grand nombre de petits joueurs tend � remplacer la pr�sence
de quelques grands �flambeurs�.
En 1995, il existe en France 154 casinos, qui totalisent un chiffre
d�affaires de 6,1 milliards de francs. (Revue �Challenge�, ao�t
1996).
Les pr�l�vements de l�Etat se montent � 3,1 milliards de francs.
-
Le
P.M.U ( Pari mutuel urbain), contr�l� par l�Etat, g�re les paris
sur les courses de chevaux, en dehors des hippodromes. Si le �tierc�
(cr�� en 1954, avec le quart�, de 1976 et le quint�, de 1989�)
reste une institution, il souffre de la concurrence des autres formes
de jeu,qui prolif�rent. Mais reste encore (en 1995), la principale
institution de jeux, avec un chiffre d�affaires de 33,8 milliards de
francs, rapportant � l�Etat 5,6 milliards.
-
La
Fran�aise des jeux, dont les produits sont accessibles aupr�s de
plus de 40 000 points de vente, g�re le loto (cr�� en 1976,
successeur de la loterie nationale, qui dispara�t en 1980), le loto
sportif (1985), et l�ensemble des jeux instantan�s, fond�s sur le
support des cartes � gratter� Elle
tend progressivement � d�passer le P.M.U quant au chiffre
d�affaires : 33,5 milliards de francs, rapportant � l�Etat 9
milliards de francs.
Retour
en haut de la page
Les
joueurs
Les
joueurs, si l�on appelle ainsi toute personne qui participe,
occasionnellement ou r�guli�rement � un jeu de hasard et d�argent, ne
sont donc en rien des individus � probl�mes, ou des marginaux. Au
contraire, ils sont devenus majoritaires dans la soci�t� actuelle.
Les
difficult�s �conomiques, la crise, sont souvent mises en avant pour
expliquer cet engouement pour les jeux d�argent : le caract�re �bloqu�
d�une soci�t� o� l�ascension deviendrait de plus en plus difficile,
s�ajoute � l�omnipr�sence de la hantise du ch�mage. Le travail, m�me
s�il devient pr�cieux, n�appara�t pas � beaucoup comme suffisant
pour atteindre des objectifs id�aux. cela expliquerait pourquoi les
joueurs se recrutent essentiellement parmi les couches populaires ou
moyennes de la soci�t� : les ouvriers repr�sentent en France 27% et les
employ�s 19% des joueurs du P.M.U.
Cs derniers constituent de fait une cat�gorie de joueurs traditionnels :
62% sont des hommes, et la moyenne d��ge est assez �lev�e, d�passant
55 ans. Les �nouveaux jeux�, notamment les cartes � gratter attirent
une client�le plus diversifi�e, plus jeune et plus f�minine.
En fait, la richesse ou la gloire (voir le succ�s du �millionnaire�,
d� certainement au fait que l�un des avantages du gagnant est le droit
de participer � une �mission de t�l�vision), objets de r�ve, ou
d�id�al, sont devenus, � travers le jeu, les �l�ments courants
d�une distraction, o� elles n�existent que comme potentialit�,
virtualit�. La plupart des joueurs �sociaux�, r�guliers ou
occasionnels, qui jouent au loto, savent que leur chance de d�crocher un
gros lot est infime : la probabilit� d�avoir une grille gagnante est de
une chance sur 13 983 816�Mais les images m�diatis�es des quelques
gagnants devenus milliardaires, ainsi que le caract�re d�mesur� des
gains, par rapport aux revenus des joueurs, sont une source infinie de r�verie.
Les strat�gies publicitaires en la mati�re sont en soi un champ de
recherches. Elles peuvent faire une place � une fausse logique,
entretenir une illusion sur les possibilit�s de gain. Le slogan �cent
pour cent des gagnants ont tent� leur chance�, peut sugg�rer un faux
syllogisme inconscient �cent pour cent des joueurs sont des gagnants�.
Mais le plus souvent, les publicit�s s�adressent ouvertement �
l�irrationnel chez l�individu, encourageant une vision magique, �r�gressive�,
bref ludique, de la chance. En 1996 par exemple, une affiche de la Fran�aise
des jeux montre un tr�fle dont la quatri�me feuille est constitu�e par
une coccinelle. L�appel ironique � la superstition, l�invocation de
la d�esse Fortune, est doubl�e d�une attribution magique aux capacit�s
du joueur potentiel : �avec une chance pareille, rien ne devrait vous r�sister
- N�oubliez pas de jouer d�ici le vendredi 13��Les visions
magiques et irrationnelles ne sont donc pas l�apanage des joueurs
pathologiques : elles sont l�un des �l�ments du plaisir li� au jeu.
La plupart des joueurs ne croient donc pas tr�s s�rieusement aux
possibilit�s de gain, mais con�oivent le jeu comme un amusement. Le
budget du jeu s�int�gre alors dans le budget familial parmi d�autres
formes de loisir, vacances, cin�ma, restaurant, etc�
Retour
en haut de la page
Le jeu pathologique - D�finitions
Pour
qualifier quelqu�un de joueur, il faut qu�il s�adonne � cette
activit� avec une certaine fr�quence, voire qu�il en ait fait une
habitude. Selon le sociologue J.P.G. Martignoni-Hutin, le joueur serait,
non celui qui joue, mais celui qui rejoue : cette d�finition peut �tre
consid�r�e comme le minimum requis�Avec Igor Kusyszyn, (professeur de
psychologie � Toronto), il est possible de distinguer plusieurs grandes
cat�gories de joueurs :
-
Les
�joueurs sociaux� : ce sont des personnes qui jouent soit
occasionnellement, soit r�guli�rement, mais dans la vie desquelles
le jeu garde une place limit�e, celle d�un loisir.
-
Les
joueurs professionnels
-
Les
joueurs pathologiques, �addicts�, seraient donc une cat�gorie �
part. A la d�pendance, s�ajoute dans leur cas la d�mesure, le fait
que le jeu est devenu centre de l�existence, au d�triment
d�autres investissements affectifs et sociaux.
Il
existe de fait, dans ce genre de classification, un d�s�quilibre, une
mise en exergue du jeu pathologique, du simple fait qu�il se retrouve
sur le m�me plan que le jeu �social�, tol�r� ou encourag�, et qui
ne pose pas de probl�mes aux usagers. Des sociologues ou des
anthropologues regrettent que l��tude d�un ph�nom�ne
quantitativement marginal puisse servir de grille principale d�analyse,
ou de base pour des d�cisions politiques, en s�appliquant de fait alors
� un ensemble beaucoup plus vaste : les joueurs dans leur ensemble
pourraient �tre p�nalis�s, ou stigmatis�s, par des analyses bas�es
sur le jeu pathologique.
Retour en haut de la page
Descriptions
du jeu pathologique
Caract�ristiques
Le
psychanalyste Edmund Bergler propose, en 1957, dans son ouvrage �the
Psychology of Gambling� une description syst�matique du �gambler�,
du joueur pathologique, qu�il oppose au �joueur du dimanche� (�not
everyone who gambles is a gambler�, �crit-il).
Selon
lui, il existe six caract�ristiques du joueur pathologique :
-
Il
doit jouer r�guli�rement : il s�agit l� d�un facteur
quantitatif, mais dont l�importance ne peut �tre n�glig�e : comme
pour l�alcoolisme, la question est ici de savoir � partir de quand
le sujet joue �trop�.
-
Le
jeu pr�vaut sur tous les autres int�r�ts
-
Il
existe chez le joueur un optimisme qui n�est pas entam� par les exp�riences
r�p�t�es d��chec.
-
Le
joueur ne s�arr�te jamais tant qu�il gagne.
-
Malgr�
les pr�cautions qu�il s�est initialement promis de prendre, il
finit par prendre trop de risques.
-
Il
existe chez lui un v�cu subjectif de �thrill� (une sensation de
frisson, d�excitation, de tension � la fois douloureuse et
plaisante), durant les phases de jeu.
Retour
en haut de la page
Le
jeu pathologique selon le D.S.M.
Comme
nous l�avons d�j� signal�, l�apparition �officielle� du jeu
pathologique comme entit� individualis�e dans la litt�rature � vis�e
m�dicale et scientifique, remonte seulement � 1980, avec son
introduction dans le D.S.M.III.
selon le D.S.M.IV (1994), le jeu pathologique est d�fini comme :
�Pratique
inadapt�e, persistante et r�p�t�e du jeu, comme en t�moignent au
moins cinq des manifestations suivantes :
1/
Pr�occupation par le jeu (p. ex. pr�occupation par la rem�moration
d�exp�riences de jeu pass�es ou par la pr�vision de tentatives
prochaines, ou par les moyens de se procurer de l�argent pour jouer).
2/ Besoin de jouer avec des sommes d�argent croissantes pour atteindre
l��tat d�excitation d�sir�..
3/ Efforts r�p�t�s mais infructueux pour contr�ler, r�duire ou arr�ter
la pratique du jeu.
4/ Agitation ou irritabilit� lors des tentatives de r�duction ou d�arr�t
de la pratique du jeu.
5/ Joue pour �chapper aux difficult�s ou pour soulager une humeur
dysphorique (p. ex. des sentiments d�impuissance, de culpabilit�,
d�anxi�t�, de d�pression)
6/ Apr�s avoir perdu de l�argent au jeu, retourne souvent jouer un
autre jour pour recouvrer ses pertes (pour se �refaire�)
7/ Ment � sa famille, � son th�rapeute ou � d�autres pour dissimuler
l�ampleur r�elle de ses habitudes de jeu
8/ Commet des actes ill�gaux, tels que falsifications, fraudes, vols ou d�tournement
d�argent pour financer la pratique du jeu
9/ Met en danger ou perd une relation affective importante, un emploi ou
des possibilit�s d��tude ou de carri�re � cause du jeu
10/ Compte sur les autres pour obtenir de l�argent et se sortir de
situations financi�res d�sesp�r�es dues au jeu
Ces
crit�res reprennent en grande part ceux qui ont �t� propos�s pour la d�finition
de la �d�pendance aux substances psychoactives�.
Ils font du jeu pathologique un ensemble �quivalent aux toxicomanies dans
une vision aujourd�hui traditionnelle o� elles sont abord�es comme entit� morbide.
D�autres grilles ou questionnaires ont �t� �labor�es dans un esprit
proche, celui de servir de base diagnostique, ainsi que d�outil d��valuation
statistique, ou d�appr�hension de l��volution d�un cas.
Ainsi du South Oaks Gambling Screen, de Lesieur et Blume (1987). Cette
grille comporte des questions essentiellement centr�es sur le jeu et
l�argent, et est consid�r�e comme un outil statistique fiable par la
plupart des auteurs.
Nous
verrons que l�association Gamblers Anonymous, Joueurs Anonymes, propose
aussi un questionnaire, � vis�e essentielle d�auto-�valuation, destin�e
� aider le futur membre � prendre conscience de ses difficult�s.
Il
existe une ad�quation et une parent� entre les crit�res diagnostiques
du D.S.M, et les questions du South Oaks Gambling Screen (S.O.G.S) : ce
dernier appara�t donc un outil adapt�, dans la mesure o� l�on accepte
les d�finitions du premier.
Retour
en haut de la page
Relations
de comorbidit�
La
trajectoire du joueur
Est
aussi souvent mise en avant comme �l�ment descriptif : avec Custer, et
apr�s Dupouy et Chatagnon, (1929) il est g�n�ralement admis que le
joueur pathologique passe par une s�rie de phases st�r�otyp�es :
- Phase de gain (winning phase) : c�est l�engagement dans le
monde du jeu, avec peut-�tre la croyance que les gains vont pouvoir r�soudre
toutes les difficult�s existentielles pr�existantes. Mais il est aussi
possible de faire l�hypoth�se que le gain, la rencontre avec la chance,
a sinon le r�le traumatique d�une �rencontre avec le r�el�, du
moins celui d�une d�stabilisation, d�une perte des rep�res ant�rieurs�
- Phase de perte (loosing phase) : le joueur va rejouer pour tenter
de �se refaire�. Avec Dupouy et Chatagnon, on pourrait souligner ici
l�apparition d�une dimension de besoin : besoin d�abord d�argent,
report� sur l�id�e de gagner � nouveau, besoin ensuite simplement de
rejouer�
- Phase de d�sespoir (desperation phase). Longtemps, c�est dans
le jeu que le sujet cherche la solution de difficult�s qui
s�accumulent.
L�ensemble de ces phases s��tend sur plusieurs ann�es, de 10 � 15
ans, favorisant l�assimilation m�taphorique du jeu pathologique � une
maladie physique progressive�
Pour Custer, il n�y aurait alors que quatre types d�issues � cette
situation : le suicide, la d�linquance et l�incarc�ration, la fuite,
ou l�appel � l�aide.
Ici encore, le parall�le s�impose avec les toxicomanies. Dans
celles-ci, il est en effet classique d�admettre que la prise de drogues
est d�abord v�cue subjectivement de fa�on tr�s positive : c�est la
d�couverte du plaisir, du �flash�, de la �plan�te�, puis la
classique lune de miel. La d�pendance m�me peut, � certaines p�riodes
et chez certains sujets, jouer le r�le d�une forme d�adaptation,
voire d�autom�dication. C�est plus tard, apr�s que la prise de
drogues ne semble plus correspondre qu�� la satisfaction d�un besoin,
et que tous les autres investissements se sont �vanouis, que le sujet
tentera de changer, de fa�ons diverses. Selon la formule des Alcooliques
Anonymes, il faut toucher le fond pour r�ellement vouloir changer, et
s�en sortir.
Cette
description par phases serait l�une des bases d�une description de
type m�dical du jeu, qui peut appara�tre comme une maladie progressive,
aux �tapes pr�visibles.
Rosecrance (1986) r�sume, pour la critiquer, cette vue du �joueur
compulsif� :
Elle serait caract�ris�e par les �l�ments suivants :
1/ Il y a un ph�nom�ne unique qui peut �tre nomm� �jeu compulsif�.
2/ Les compulsifs sont qualitativement diff�rents des autres
joueurs.(�)
3/ Les compulsifs manifestent progressivement une �perte de contr�le�
qui les rend incapables d�arr�ter de jouer.
4/ Le jeu compulsif est un �tat progressif qui suit un d�veloppement
inexorable � travers une s�rie de phases distinctes :
-a/ Le succ�s initial, accentu� par un �gros score�, conduit
� l�attente irr�aliste que des gains encore plus grands seront obtenus
par une augmentation du jeu.
-b/ Avec l�augmentation du jeu, le succ�s diminue�
-c/ Le besoin de continuer � jouer (�) devient une compulsion d�vorante.
-d/ La conception de l�argent se change en moyen plut�t qu�en
fin.
-e/ Le joueur souffre de troubles psychologiques- des sentiments de
culpabilit� inconscients le m�nent � une situation
o� il est incapable de s�arr�ter quand il gagne.
-f/ Le stade suivant est celui de la qu�te (chase) (�)
-g/ Des tentatives fr�quentes d�abstinence�
-h/ Le joueur touche le fond�
5/
Le jeu compulsif est une condition permanente et irr�versible. Le seul
�traitement� est l�abstinence totale et irr�versible.
Retour
en haut de la page
�pid�miologie,
profils sociologiques
Les
�tudes en population g�n�rale tendent � d�montrer que le jeu
pathologique est relativement r�pandu : le D.S.M IIIR en estime la pr�valence
entre 2% et 3% de la population adulte., et note que le trouble est plus
fr�quent chez l�homme que chez la femme.
Aux �tats-Unis (Lesieur), comme au Canada (Ladouceur), des �tudes
tendent � d�montrer que cette pr�valence est de l�ordre de 1 � 2%,
plus si l�on inclut dans la recherche les �joueurs � probl�me�.
Ces chiffres sont l�objet de d�bats, et d�autres auteurs tendent �
montrer qu�ils seraient plus pr�s de 0,5%� Mais l�important est de
noter que pour tous, cette pr�valence du jeu pathologique est nettement
plus importante dans les pays ou les �tats dans lesquels le jeu est l�galis�,
et le jeu �normal� r�pandu. Le Nevada reste une r�gion o� le jeu
pathologique est tr�s r�pandu, alors que l�Iowa, dans lequel le jeu
est r�prim�, compte moins de joueurs pathologiques que les autres �tats
nord-am�ricains. En Europe, l�Espagne serait le pays o� le probl�me
est le plus important, du fait de la tr�s grande diffusion des jeux,
notamment des machines � sous�
Environ
500 000 machines � sous sont r�parties sur le territoire ib�rique,
elles sont ins�r�es dans presque tous les lieux publics et on estime que
8% des Espagnols s�y adonnent, d�autant que les tragaperras, avec
leurs multiples boutons et combinaisons, leur voix de synth�se, donnent
au joueur l�illusion du contr�le. Le juego
est devenu quasiment la premi�re industrie du pays et l�Espagne
occuperait le troisi�me rang mondial en mati�re de d�penses li�es aux
jeux de hasard (l��quivalent de 120 milliards de Francs)
Les
�tudes indiquent aussi qu�il s�agit d�une probl�matique surtout
masculine, jeune (surrepr�sentation des �tudiants), et qui touche
particuli�rement les couches socialement d�favoris�es ou minoritaires
de la population.
Il semble d�ailleurs que jeunes, pauvres, et femmes, soient sous-repr�sent�s
dans la population admise en traitement, donc dans certaines �tudes.
Le
fait que le jeu pathologique soit avant tout masculin, comme d�ailleurs
les toxicomanies aux drogues illicites, et, de fa�on moins nette
aujourd�hui, l�alcoolisme, n�est pas sans poser un certain nombre de
questions.
Les diff�rences entre hommes et femmes concernent tant de niveaux, que
les causes de cette diff�renciation ne peuvent �tre �videntes a priori.
Mais ce serait une d�marche pr�cipit�e que de chercher les raisons de
cette pr�dominance masculine dans le champ de la physiologie, ou de la
psychologie.
(Selon Bergler, il n�y a gu�re de diff�rences entre les raisons, les d�terminismes
psychiques, qui conduisent une femme ou un homme � jouer. Plus r�cemment,
R. Tostain dit la m�me chose, en des termes plus sophistiqu�s :
�Que des femmes, elles aussi, mettent leur phallus sur le tapis ne me
para�t pas �tre un obstacle � cette interpr�tation. Si une femme est
vraiment joueuse, on retrouvera sans doute que pour n�avoir jamais tout
� fait renonc� � l�avoir du p�nis, la question de l��tre du
phallus puisse pour elle en ces termes se poser�).
Avant d�entrer dans de telles consid�rations, ou de les critiquer, il
nous appara�t n�cessaire de tenir compte du fait que la culture,
l�histoire, les modes soci�taux de r�gulation du jeu, sont encore ici
au premier plan, et vont influencer � la fois le contexte des �tudes, et
les conceptions des chercheurs.
Les femmes ne jouent pas dans des cercles interdits aux femmes, comme
elles ne buvaient pas dans des tavernes r�serv�es aux hommes.
M�me si les s�gr�gations tendent, dans les cultures actuellement
dominantes, � devenir obsol�tes, un surcro�t de stigmatisation peut
continuer � s�attacher au jeu, lorsqu�il s�agit de jeu au f�minin.
L�imagerie traditionnelle, depuis le Moyen-Age et l��ge classique,
traite des femmes et du jeu de fa�on en quelque sorte lat�rale :
- D�une part, comme objet de consommation, la prostitu�e ou la
courtisane participe de l�imagerie des cercles et maisons de jeu comme
lieux de d�bauche et de perdition, zone de plaisirs troubles, autres,
interdits, le sexe, l�alcool, les drogues�
- D�autre part, comme victime, c�est l�image (et souvent encore la r�alit�),
de l��pouse et de la m�re, mise � mal, menac�e de destruction, par
la passion pour le jeu du mari et du p�re. Les premi�res r�percussions
qui viennent attester le caract�re d�mesur�, anormal,
�pathologique�, du jeu, sont d�ordre domestique.
C�est encore la femme du joueur, plus que la joueuse, qui est souvent �tudi�e,
et le parall�le avec l�alcoolisme s�impose ici encore.
Les descriptions montrent alors que longtemps il existe une �c�cit�,
une absence de prise de conscience des difficult�s du conjoint,
d�autant que celui-ci les masque. Puis de longues tentatives de soutien,
de remise en question, mais dans un contexte de tol�rance, voire
l�acceptation d�un r�le de victime r�demptrice qui est souvent
l�objet des r�flexions des observateurs.
Retour
en haut de la page
Le
jeu pathologique en France
Une
�tude men�e en France aupr�s des personnes consultant le service t�l�phonique
S.O.S. Joueurs (A. Achour-Gaillard, 1993) donne un aper�u de la
population fran�aise des joueurs d�pendants.
Ce travail met en �vidence une tr�s forte surrepr�sentation des hommes
(plus de 90% des sujets), un �ge de 25 � 44 ans, la tranche la plus repr�sent�e
�tant les 40 - 44 ans.
Une majorit� de ces joueurs sont mari�s, et ont des enfants.
La plupart ne jouent qu�� un seul jeu, les femmes surtout aux machines
� sous.
Une majorit� de ces joueurs sont surendett�s, et l�alt�ration des
relations conjugales est une cons�quence fr�quente.
Pr�s de 20% des joueurs ont commis des d�lits.
L�auteur remarque � la fois que cette �tude n�est qu�exploratoire,
mais qu�elle semble en accord avec les r�sultats des recherches nord-am�ricaines
: les diff�rences de culture, quant au jeu, comme les diff�rences de
conception, quant � l�abord de ce probl�me, n�emp�chent donc pas
une convergence, dans l�appr�ciation globale du ph�nom�ne ou le
profil des joueurs pathologiques.
Retour
en haut de la page
Comorbidit�
psychiatrique
D�pression
et �tats maniaques ou hypomaniaques
Les
d�penses inconsid�r�es, parmi lesquelles pourrait se trouver une fr�n�sie
de jeu, sont l�un des premiers sympt�mes classiquement d�crits en
psychiatrie dans les d�buts d�un �pisode maniaque ou hypomaniaque,
qu�il entre ou non dans le cadre d�un trouble bipolaire (psychose
maniaco-d�pressive).
Les
�tudes �pid�miologiques ou cliniques tendent � montrer une importante
relation, entre la d�pression et le jeu pathologique
Personnalit�s
antisociales
La
d�linquance est un �l�ment fr�quemment retrouv� dans les cas de jeu
pathologique. Le D.S.M. insiste sur cette dimension, apr�s avoir (dans sa
troisi�me version), exclu les �troubles de la personnalit�
antisociale�, du cadre du jeu pathologique. Selon le D.S.M. IIIR, �Les
probl�mes li�s au jeu sont souvent associ�s � la personnalit�
antisociale, et, dans le jeu pathologique, le comportement antisocial est
fr�quent. Lorsque les deux troubles sont pr�sents, les deux diagnostics
doivent �tre faits.�
Usage
de drogues et d�alcool
Selon
une �tude de Lesieur et Blume (1993), qui ont pass� en revue
l�essentiel de la litt�rature technique en la mati�re, les
recoupements (�overlaps�) entre jeu pathologique et abus de substances
psychoactives sont tr�s larges. Parmi les personnes en traitement pour d�pendance
� l�alcool ou aux drogues, de 9 � 14% sont aussi des joueurs
pathologiques. Ces pourcentages sont � multiplier par deux si l�on
inclut la cat�gorie des �joueurs � probl�mes�.
Dans l�autre sens, si l�on �tudie des cohortes de joueurs
pathologiques en traitement, de 47 � 52% d�entre eux se r�v�lent
aussi pr�senter une d�pendance ou un abus d�usage d�alcool ou de
drogues.
Nous
verrons qu�il existe des �l�ments communs entre d�une part
l�alcoolisme ou la toxicomanie, d�autre part le jeu pathologique.
Aussi que certaines personnes peuvent passer de l�une � l�autre de
ces �pathologies�.
Troubles
des conduites alimentaires
Des
parall�les th�oriques peuvent aussi exister entre jeu pathologique et
troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, dans la mesure o�
ces troubles sont avant tout d�crits en termes de comportements
auto-inflig�s, et comportent les caract�ristiques d�impulsivit�, ou
de compulsivit�, qui sont �voqu�s dans le cas du jeu pathologique.
Les �tudes sur le sujet sont rares, mais il semble (Lesieur et coll.) que
chez les femmes qui s�adonnent au jeu de fa�on excessive, les
boulimiques soient nettement sur repr�sent�es.
Retour
en haut de la page
Mod�les
explicatifs
Th�ories
psychanalytiques
Freud
et Dosto�evski
Le
texte psychanalytique le plus c�l�bre sur le jeu n�est pas le premier
en date : il date de 1928, alors que par exemple Von Hattinberg avait
trait� du jeu d�s 1914. Il pr�sente un paradoxe de plus : ce n�est
pas un texte sur le jeu, ni une monographie sur un patient joueur, mais
sur une personnalit� c�l�bre, que Freud connaissait par ses oeuvres, et
par des �tudes biographiques.
C�est la personne de Dosto�evski, non seulement sa passion du jeu, que
Freud tente de cerner.
Ce bref essai a �t� depuis sa parution abondamment comment� et critiqu�,
sous des angles divers.
Ce petit texte - et le fait qu�il continue � �tre abondamment cit� le
prouve - contient sans doute, et jusque dans ses r�ticences, une part
essentielle des r�flexions psychanalytiques sur le jeu, dans lequel �on
ne peut voir (�) autre chose qu�un acc�s indiscutable de passion
pathologique�
Freud
�limine d�entr�e l�id�e que l�app�t du gain soit la cause du
jeu. Dosto�evski est d�ailleurs tr�s explicite sur ce point : il n�y
a d�autre but que �le jeu pour le jeu�.
Et cette passion, selon Freud, a la fonction psychique d�une conduite
d�autopunition. Ainsi s��claire la s�quence cyclique et r�p�titive,
chez Dosto�evski, d�acc�s fr�n�tique et ruineux de jeu, puis de
phase de remords et auto flagellation, enfin de renouveau de la cr�ativit�
litt�raire : � Quand le sentiment de culpabilit� de Dosto�evski �tait
satisfait par les punitions qu�il s��tait inflig�es � lui-m�me,
alors son inhibition au travail �tait lev�e et il s�autorisait �
faire quelques pas sur la voie du succ�s�.
Le but de l�analyse est donc de chercher en quoi ce besoin inconscient
de se punir est fond�, quelles sont les sources profondes du sentiment de
culpabilit�. La �digression� freudienne sur la nouvelle de S. Zweig
vise � �tablir le lien entre ce sentiment de culpabilit�, ou plut�t le
besoin de punition, et une origine pubertaire, dans le rapprochement des
fantasmes oedipiens et la masturbation : � Le fantasme tient en
ceci : la m�re pourrait elle m�me initier le jeune homme � la vie
sexuelle pour le pr�server des dangers redout�s de l�onanisme. Notons
que le parall�le soulev� par Freud entre le jeu et la masturbation peut
s�appliquer � tout l�ensemble des �pathologies des conduites�,
regroup�es dans le cadre des �troubles des impulsions� :
trichotillomanie, pyromanie, kleptomanie� Comme le jeu, ces acc�s
passionnels, � la fois irr�sistibles et ��gosyntones� peuvent �tre
vus comme une d�rivation, une substitution, de la premi�re �grande
habitude� probl�matique (du moins en 1928�), la masturbation.
Mais
la conduite d�autopunition et le sentiment conscient ou inconscient de
culpabilit� de Dosto�evski proviennent aussi de l�autre versant de la
structure oedipienne : l�ambivalence envers le p�re, qui inclut
l�agressivit� meurtri�re.
Le parricide, qui hante l�oeuvre de l��crivain, serait la cl� de vo�te
de sa conduite masochiste.
Sch�matiquement, la menace de castration s�articule autour de deux
positions diff�rentes du moi : d�une part, la menace directe de
punition li�e � la haine envers le p�re, le d�sir de le supprimer, de
le remplacer. D�autre part, effet de la bisexualit� universelle, une
position passive de soumission, fantasme de tenir le r�le d�objet
sexuel du p�re, qui raviverait l�angoisse de castration.
La perte au jeu devient cette punition par l�entit� paternelle : �Toute
punition est bien dans son fond la castration et, comme telle,
satisfaction de la vieille attitude passive envers le p�re. Le destin
lui-m�me n�est en d�finitive qu�une projection ult�rieure du p�re.�
J.B.
Pontalis remarque que si Freud, d�une certaine mani�re, r�siste � la
�pathologie� de Dosto�evski, c�est que chez ce dernier elle met en
acte ce meurtre du p�re qui, fantasm�, symbolis�, est l�un des pivots
de la pens�e freudienne. La biographie d�Henri Troyat montre en effet
que le voeu de mort du p�re �tait chez Dosto�evski tout � fait
conscient, et non refoul�, et que la mort violente de ce p�re fut salu�e
par le fils comme une lib�ration�
Reste
que ce texte propose, comme m�canisme profond de la conduite du joueur
pathologique, une probl�matique qui est celle de l�int�gration de la
Loi, dans la mesure o� le meurtre du p�re, et les m�canismes de son
refoulement ou de son d�passement, sont
� la fois � la base, pour l�individu, de la constitution des instances
morales, et pour l�humanit� (selon la vision du p�re originel de la
horde primitive de �Totem et Tabou ), une condition de l�int�gration
de l�individu comme membre de la communaut� humaine, de la
civilisation.
Le joueur selon E. Bergler
�The
psychology of gambling�, ouvrage du m�decin psychanalyste am�ricain
Edmund Bergler fit longtemps autorit� en mati�re de ce qui aujourd�hui
est jeu compulsif, pathologique, ou addictif.
Expression d�une �n�vrose de base� correspondant, comme
l�alcoolisme, � une r�gression orale, le jeu serait la mise en acte
d�une s�quence toujours identique, repr�sentant une tentative
illusoire d��liminer purement et simplement les d�sagr�ments li�s au
principe de r�alit�, au profit du seul principe de plaisir.
Cette op�ration n�cessite un retour � la fiction de la toute-puissance
infantile, et la r�bellion contre la loi parentale se traduit
directement, chez le joueur, par une r�bellion latente contre la logique.
L�agression inconsciente (contre les parents, repr�sentant la loi, et
la r�alit�), est suivie d�un besoin d�autopunition, impliquant chez
le joueur la n�cessit� psychique de la perte.
Une s�quence de jeu correspondrait donc au sc�nario fantasmatique
suivant :
- Premi�rement, je suis tout-puissant, je commande le destin, et je me
moque des r�gles, qui ne sont qu�hypocrisie.
- Deuxi�mement, je suis puni, mais je ne m�en soucie pas int�rieurement,
bien que consciemment je sois une victime innocente.
- Enfin, je suis sup�rieur aux g�ants qui me punissent : c�est en
effet moi qui les fait me punir�
Ce sch�ma permettrait d��claircir � la fois les conduites du joueur
type, le �joueur classique� de Bergler, et certains traits
particuliers de certains joueurs :
Le
�myst�rieux frisson�, excitation et tension � la fois agr�able et d�sagr�able,
l�ineffable du jeu, serait simplement li� au plaisir de la reviviscence
de la toute-puissance infantile, m�l� � l�angoisse de l�attente de
la punition.
Autres travaux
-
Il convient de signaler l�importance d�un auteur, longtemps consid�r�
comme majeur, qui s�inscrit dans une optique d�utilisation clinique,
th�rapeutique, de la psychanalyse, et dont la proximit� de d�marche
avec Bergler tient sans doute � une trajectoire relativement comparable.
Otto Fenichel est aussi un psychanalyste europ�en, qui contribua au d�veloppement
de cette discipline aux �tats-Unis.
Dans son travail impressionnant, �la psychanalyse des n�vroses�,
publi� en 1945, il tente de faire le tour de l�ensemble des formes de
pathologie mentale, et de montrer en quoi la psychanalyse peut en �clairer
la compr�hension. Il fait une place au jeu, et cite Bergler � ce propos
(parmi les 1646 r�f�rences bibliographiques de l�ouvrage�).
Du jeu, �combat contre le destin�, il conclut que � Sous la pression
des tensions internes, le caract�re badin peut se perdre ; le Moi ne peut
plus contr�ler ce qu�il a mis en train, et est submerg� par un cercle
vicieux d�anxi�t� et de besoin violent de r�assurance, angoissant par
son intensit�. Le passe-temps primitif est maintenant une question de vie
ou de mort.�
Fenichel fait par ailleurs la distinction entre des n�vroses
�compulsives�, o� le sujet est obs�d� par l�id�e, comme impos�e
de l�ext�rieur, de commettre un acte, et contre laquelle il lutte, et
des �n�vroses impulsives�, o� l�acte est commis de fa�on syntone
au moi : la base de la classification des �troubles des impulsions� du
D.S.M. trouve ici son origine, et Fenichel classe d�ailleurs dans les n�vroses
impulsives, outre le jeu, la pyromanie et les fugues impulsives. Proche
des impulsions, se trouve pour lui la cat�gorie des �caract�res domin�s
par leurs instincts�, au premier rang desquels, les toxicomanes (et
alcooliques). Il d�crit aussi dans la m�me cat�gorie des �addictions
sans toxique�, toxicomanes sans drogue, boulimie et autres troubles des
conduites alimentaires.
La
psychanalyse, particuli�rement nord-am�ricaine, est donc pour beaucoup
dans une perception du jeu comme pathologie, et bien des descriptions
actuelles sont influenc�es par ces conceptions.
Bergler, comme Fenichel, se situent dans le cadre d�approches cliniques
� vis�e pragmatique, non �loign�es d�une vision m�dicale.
Jacques Lacan, dans son s�minaire sur la lettre vol�e, pose de fa�on
plus �philosophique� et lapidaire la question du joueur :
� Qu'es-tu,
figure du d� que je retourne dans ta rencontre (tuch) avec ma fortune?
Rien, sinon cette pr�sence de la mort qui fait de la vie humaine ce
sursis obtenu de matin en matin ... �
Les signifiants, la r�ponse du d�, est bien de l�ordre de l�ultime,
de ce qui d�passe le simple d�sir humain : � Marquer les six c�t�s
d�un d�, faire rouler le d� ; de ce d� qui roule surgit le d�sir. Je
ne dis pas d�sir humain, car, en fin de compte, l�homme qui joue avec
le d� est captif du d�sir ainsi mis en jeu. Il ne sait pas l�origine
de son d�sir, roulant avec le symbole �crit sur les six faces.� (S�minaire,
livre 2).
Dans
un article de 1967, (revue L�Inconscient), �Le joueur, essai
psychanalytique�, R. Tostain reprend la question du sens de la conduite
du joueur.
Le hasard, pour le joueur, serait �cet Autre suppos� savoir auquel il
peut se fier, se confier, tout comme le faisaient les Anciens quand ils
lisaient dans le ciel l�heure de la bataille � livrer.�
Reformulant les analyses freudiennes, la probl�matique de la castration
devient clairement, dans son expos�, celle du rapport du sujet � la Loi,
qui n�est pas simplement �crasement par la culpabilit�, et simple
besoin de punition :
� En ce sens, il ne me para�t pas que le joueur d�sire inconsciemment
perdre pour satisfaire � un bien hypoth�tique sentiment de culpabilit�
qui n�a nulle place dans la dynamique du d�sir.
Ce qu�il veut, c�est se soumettre � la Loi. Cette Loi qui exige
qu�il renonce � son avoir pour pouvoir donner. Il agit comme s�il
savait qu�il n�y a de don que de ce qu�on a pas parce qu�on a
renonc� � l�avoir.�
Il y a donc dans le cas du joueur une probl�matique tr�s particuli�re,
qui serait � situer dans une forme de n�gation et de reconnaissance de
la n�cessit� de la castration, de l�acc�s la Loi.
L�origine de cette singuli�re attitude envers la Loi symbolique,
�l�ordre symbolique, l�gal, celui du signifiant phallique� (
vouloir, comme si l�on savait, y acc�der�), est � chercher dans
quelque dysfonctionnement de la fonction paternelle, et Tostain revient �
Dosto�evski, pour tenter d��clairer �ce qui, au niveau du nom du p�re,
manque que son fils tente de combler en jouant.�. Et la cl� en serait
non, comme pour Freud, dans le caract�re inconscient du voeu de
parricide, mais au contraire dans le fait qu�il n�ait pas pu le
refouler�
Retour
en haut de la page
Mod�les
comportementalistes et cognitifs
Le
comportementalisme op�rant ou skinn�rien
Le
conditionnement op�rant est sans doute le mode d�explication le plus
simple et le plus �vident d�une d�pendance au jeu, si celle-ci est con�ue
comme un comportement, ou un ensemble de comportements.
Rappelons que les travaux de Skinner sont d�riv�s des �tudes sur
l�apprentissage animal, initialement dans la suite de la �loi de
l�effet� de Thorndike.
Il s�agit donc surtout au d�part de l��tude de comportements simples
et individuels.
Le sch�ma de base en est tr�s simple, en �feed back� : un
comportement produit une cons�quence, et cette cons�quence pourra
renforcer ou non ce comportement.
Le renforcement se traduit par une augmentation de l��mission du m�me
comportement, en fr�quence ou en intensit�.
L�op�rant, le comportement �tudi�, peut donc �tre l�objet d�un
renforcement positif, ou d�un renforcement n�gatif, si la cons�quence
entra�ne une diminution de la fr�quence du comportement. Il peut aussi
�s��teindre�, en l�absence de renfor�ateur positif.
Les contingences de renforcement repr�sentent le lien entre le
comportement et sa cons�quence.
La contigu�t� est le rapprochement temporel de ces deux donn�es,
condition n�cessaire aux renforcements tant positif que n�gatif. (Chez
le pigeon, le renfor�ateur doit suivre de six secondes l��mission du
comportement pour �tre efficace�).
A priori, de fa�on g�n�rale, un renfor�ateur imm�diat a plus de
chances d��tre efficace qu�un renfor�ateur diff�r�.
Les renfor�ateurs primaires sont ceux qui sont li�s aux fonctions
vitales, physiologiques, comme la nourriture.
L�exp�rimentation animale montre qu�il existe aussi des renfor�ateurs
secondaires, acquis : si par exemple un singe apprend � obtenir en
poussant un levier, un jeton qui lui-m�me permet d�obtenir de la
nourriture, le jeton est un renfor�ateur secondaire.
Un renfor�ateur secondaire, s�il permet l�acc�s � divers renfor�ateurs
primaires, pr�sente l�avantage d��viter la saturation,
l�inefficacit� qui r�sulte de l�emploi du m�me renfor�ateur
primaire. (Le pigeon peut cesser d'avoir faim�).
La g�n�ralisation du comportement est le fait qu�il continue � �tre
�mis, en l�absence du renfor�ateur initial.
Le �principe de Premack� �nonce que tout comportement �mis r�guli�rement
� une fr�quence �lev�e peut �tre lui-m�me utilis� comme renfor�ateur.
Les programmes de renforcement d�finissent le mode de distribution des
renfor�ateurs par rapport � l��mission d�un comportement. Sont
distingu�s des programmes � proportion, o� le renfor�ateur suit un
certain nombre d��missions du comportement (si ce nombre est fixe, il
s�agit d�un programme � proportion fixe), et des programmes �
intervalle, o� le renfor�ateur est donn� � certains intervalles pr�d�termin�s,
fixes ou variables.
De fa�on g�n�rale, la rapidit� du renforcement d�un comportement
sera grande dans des programmes � renforcement quasi-syst�matiques. Mais
des programmes � proportion et intervalles al�atoires engendreront une
constance, une g�n�ralisation du comportement�
Ce rappel succinct permet de voir comment, si le jeu est assimil� � un
comportement, il est tentant de voir dans l�argent du gain un renfor�ateur
secondaire.
Les �machines � produire du hasard�, machines � sous, cartes �
gratter, etc., auront alors valeur de programmes de renforcement al�atoires.
C�est ainsi qu�elles sont trait�es par les concepteurs, qui visent
par d�finition � renforcer le comportement-cible �mettre de l�argent
dans la machine��
B.F. Skinner, pape du b�haviorisme, ne pouvait manquer d�insister sur
ce rapprochement d�une conduite humaine avec les m�canismes du dressage
animal.
En 1953, dans �science and human behavior� (Appleton Century Crofts,
N.Y), il affirme :
� L�efficacit� de tels programmes � produire des taux de r�ponses �lev�s
est connue depuis longtemps des propri�taires des �tablissements de jeu.
Machines � sous, roulette, d�s, courses de chevaux, etc. rapportent
selon un programme de renforcement � rapport variable (variable
ratio-reinforcement).(�) Le joueur pathologique est l�exemple m�me du
r�sultat. Comme le pigeon avec ses cinq r�ponses par seconde pendant
plusieurs heures, il est la victime d�une contingence de renforcement
impr�visible. Le gain ou la perte au long terme est presque sans
importance (irrelevant) au regard de l�efficacit� de ce programme.�
Le
comportementalisme r�pondant ou pavlovien
Le
conditionnement r�pondant constitue le champ des classiques �r�flexes
conditionn�s�. Le principe en est bien connu, et se d�roule en trois
phases :
- d�abord, un stimulus inconditionnel entra�ne une r�ponse
inconditionnelle. (La pr�sentation de nourriture fait saliver le chien).
- Ensuite, un stimulus conditionnel s�ajoute au stimulus inconditionnel,
et la m�me r�ponse inconditionnelle se produit (le son de la clochette
s�ajoute � la pr�sentation de nourriture)
- Enfin, le stimulus conditionnel produit la r�ponse, conditionnelle.
Des
m�canismes de ce type sont �voqu�s en mati�re de toxicomanies pour
expliquer certains aspects de la d�pendance, et notamment l�importance
du contexte, du cadre, des �rituels� associ�s � la prise de drogue
ou � la conduite addictive. Des �retours de manque�, ou des
impulsions � reprendre de la drogue sont ainsi souvent not�s chez des h�ro�nomanes
sevr�s, lorsqu�ils se retrouvent dans leurs anciens lieux de �d�fonce�,
ou simplement qu�ils entendent une musique, qui est associ�e au
souvenir de la drogue.
Souvent
de fa�on implicite, les programmes de traitement d�inspiration
comportementaliste font une grande part � ce versant de conditionnement r�pondant
: notamment lorsqu�ils insistent sur la n�cessit�, pour un sujet, d��viter
les lieux, les ambiances, les rituels, qui sont rattach�s au jeu lui-m�me.
Ces
deux aspects du comportementalisme peuvent-ils expliquer la conduite
d�un joueur excessif ? Il convient de distinguer en effet le m�canisme
d�apprentissage ou d�acquisition d�un comportement, de la complexit�
de l�engagement d�un �tre humain dans une conduite.
La question pourrait �tre reformul�e : m�me si l�on admet que les m�canismes
de conditionnement sont � la base des comportements, faut-il en d�duire
que le seul hasard des contingences de renforcement va transformer un
individu en toxicomane ou joueur pathologique ?
Selon par exemple G. Bateson, qui parle en termes de niveaux
d�apprentissage, il y aurait l� une erreur manifeste :
l�apprentissage par conditionnement, celui des comportements, est d�un
autre niveau logique que l�apprentissage de conduites complexes, qui
impliquent un �apprentissage des apprentissages� du niveau pr�c�dent�
Au
service des recherches biologiques, neurophysiologiques ou
pharmacologiques, le comportementalisme et le dressage animal permettent
d'explorer les deux axes principaux des m�canismes de la d�pendance :
- D'une part, la tol�rance, le fait que la prise r�p�t�e d'une
substance entra�ne au bout d'un certain temps la n�cessit� d'augmenter
les doses pour obtenir un effet similaire.
La notion de processus opposants ("opponent process" de Solomon)
met en valeur l'importance potentielle de ce m�canisme, m�me en ce qui
concerne des addictions sans drogues : sch�matiquement, tout se passe
comme si l'organisme s�cr�tait peu � peu un processus inverse � celui
qu'induit la substance, ou la conduite addictive. La diminution des
effets, la n�cessit� d'augmenter les doses de substance, ou la fr�quence
de la conduite, serait la r�sultante de ces processus contradictoires (un
effet agr�able, apr�s un certain temps, entra�ne la production par
l'organisme d'un processus d�sagr�able. La somme des deux est per�ue
par l'individu comme la simple diminution de l'effet agr�able�).
Les syndromes de sevrage peuvent alors �tre expliqu�s par la persistance
pendant un certain temps, du processus opposant (g�n�ralement d�sagr�able),
apr�s l'arr�t du processus initial (g�n�ralement agr�able).
- D'autre part, la sensibilisation : c'est le fait qu'un individu, qui a
�t� "accroch�", d�pendant � une substance, va garder dans
son organisme une trace de cette d�pendance. M�me apr�s un long temps
de sevrage et d'abstinence, il sera plus sensible qu'un autre aux effets
du "produit". Il en redeviendra aussi plus vite � nouveau d�pendant.
Le
rapprochement entre ces consid�rations et le v�cu addictif appara�t tr�s
�clairant. On peut mieux entrevoir comment ces m�canismes peuvent �tre
en cause dans des processus d'escalade, comme celui d�crit dans les
"phases" du jeu pathologique.
Mais il faut se garder des g�n�ralisations h�tives, et ne pas oublier
que les �mod�les animaux� ne sont transposables � l�homme que de
fa�on tr�s m�taphorique, et tendent � se complexifier.
Ceci notamment par la place de plus en plus grande qu'accordent les
chercheurs au contexte, � l'environnement, � l'�thologie�
Retour
en haut de la page
Des
approches cognitives
Tendent de prendre acte de cette diff�rence des niveaux
d�apprentissage, et de la complexit� des conduites humaines, en s�int�ressant
aux croyances, aux attentes, et aux repr�sentations des sujets concern�s.
Cet angle de regard, en mati�re de toxicomanies ou d�addictions au sens
large a �t� particuli�rement d�velopp� aux �tats-Unis par G. A.
Marlatt, et en mati�re de jeu pathologique, au Qu�bec par R. Ladouceur.
La premi�re motivation des joueurs, dont l�activit� remonte g�n�ralement
� l�adolescence, est de gagner de l�argent. Cet aspect de la conduite
est renforc� dans les cas de gains initiaux, phase de gain ou �big win�.
Mais surtout, Ladouceur insiste sur le rapport particulier que le joueur
entretient avec le hasard, et sp�cialement sur la conviction ou la
croyance en sa propre capacit� � influencer le cours du jeu.
Plusieurs analyses de situations r�elles, ou des protocoles exp�rimentaux,
permettent de v�rifier cette hypoth�se :
- Entre des jeux o� les possibilit�s, les probabilit�s objectives de
gain sont les m�mes, et totalement ind�pendantes de l�activit� du
joueur, celui-ci aura d�autant plus tendance � s�attribuer le r�sultat,
qu�il aura exerc� une part active dans le d�roulement de la s�quence
de jeu. Autrement dit, au niveau d�une conviction int�rieure, ce
n�est jamais la m�me chose de regarder quelqu�un d�autre lancer le
d�, ou de le lancer soi-m�me.
��plus le joueur participait au jeu, plus il misait d�argent et plus
il effectuait des paris risqu�s (�) Ce r�sultat se confirma autant
chez les joueurs r�guliers que chez les joueurs occasionnels�.
- Les joueurs pathologiques entretiennent plus que d�autres une
conception �inad�quate�, non conforme aux logiques math�matiques,
qui leur fait nier ou sous-estimer la part du hasard dans le d�roulement
du jeu.
Mais m�me chez ceux qui acceptent le fait que le jeu auquel ils
s�adonnent est de pur hasard, les conceptions s�av�rent erron�es en
terme de calcul des probabilit�s. Avec G.A. Marlatt, il est possible de
dire que ces personnes attendent du jeu plus que ce qui serait
raisonnable, comme les �addicts� de leur drogue.
Nous retrouvons donc ici, au niveau des repr�sentations et des attentes
des individus, les diff�rents aspects �voqu�s dans la pratique du jeu
en g�n�ral, quant � la reconnaissance/n�gation du hasard. Le recours
aux syst�mes et martingales est parfois aussi peu rationnel que le
recours aux f�tiches, pattes de lapins ou tr�fles � quatre feuilles�
- La facilit� avec laquelle un sujet va tendre � s�attribuer
faussement un pouvoir sur des �v�nements al�atoires pourrait �tre li�e
� un profil psychologique souvent relev� chez les joueurs pathologiques
:
Ce joueur est le plus souvent un homme, qui aime la compagnie, les
groupes, qui se conduit en meneur, en d�cideur, se montre hyperactif et
extraverti, d�une intelligence et d�un sens pratique sup�rieurs � la
moyenne. L�exp�rience lui a donc appris qu�il savait gagner, prendre
des risques, et l�important pour lui est de gagner. Son milieu
d�origine aurait particuli�rement valoris� l�argent et le pouvoir�
-
Les �tapes d�une �carri�re� de joueur ne font souvent, par
l�analyse que tente d�en faire lui-m�me le sujet, que renforcer les
croyances erron�es initiales. ( Les raisons d�un �chec ne seront que
rationalisations, puis motifs d�essayer de gagner � nouveau).
Marlatt montre que nombre de �rechutes� sont souvent pr�par�es par
les sujets, � leur propre insu. Des d�cisions apparemment sans aucun
rapport, mais en fait des pr�textes, vont les conduire � s�exposer �
nouveau au jeu. Par exemple (de ces �apparently irrelevant decisions�),
pour un Am�ricain joueur, le fait de retourner � Las Vegas, juste pour
voir le paysage�
Retour
en haut de la page
La
question de la recherche de sensations
La
recherche active de sensations fortes est � l��vidence l�une des
motivations, le plus souvent tout � fait consciente, des joueurs.
Avec le Pr. J. Ades, il est permis de consid�rer que � La recherche de
sensations peut ainsi occuper une place centrale dans un mod�le
bio-psycho-comportemental de l�addiction. Elle permet, notamment,
d�expliciter les relations entre d�pendances aux substances
psycho-actives (alcool, drogues, tabac�) et d�pendance � des
comportements sans usage de drogue, dont la parent� peut reposer sur la
pr�sence d�un tel facteur psycho-biologique favorisant.�
La notion de recherche de sensation a �t� d�velopp�e aux �tats-Unis
par Marvin Zuckerman, qui a d�velopp� sous forme de questionnaire une �chelle
de recherche de sensations (Sensation Seeking Scale).
Progressivement, cet auteur en est venu � consid�rer la recherche de
sensations comme un trait de personnalit�, qui pourrait avoir des bases
physiologiques, voire g�n�tiques.
Certains sujets, plus que d�autres, auraient besoin d��prouver des
sensations fortes, ou plut�t pr�senteraient une recherche de
stimulations �lev�es, ces sujets �tant moins sensibles que d�autres,
moins aptes � ressentir des �prouv�s li�s � des stimulations
banales�
Cette vision presque �physiologique�, permet le rapprochement de la
recherche de sensation humaine avec les conduites d�exploration et de
nouveaut� chez les animaux, qui font l�objet d��tudes
neurophysiologiques.
Parmi les �l�ments explor�s par l��chelle de recherche de
sensations, on retrouve :
- Un facteur de recherche de danger et d�aventure
- Un facteur de recherche d�exp�riences.
- Un facteur de d�sinhibition.
- Un facteur de susceptibilit� � l�ennui.
globalement, cette �chelle permet de distinguer des forts chercheurs de
sensations (H.S : High sensation seekers) de faibles chercheurs de
sensations (L.S : Low sensation seekers).
Si les toxicomanes ou alcooliques sont tr�s r�guli�rement cot�s comme
�H.S�, il devrait en �tre de m�me des joueurs pathologiques.
Or, la litt�rature en la mati�re est quelque peu contradictoire, et il
serait pr�matur� de la consid�rer comme suffisante. Selon les �tudes la corr�lation entre jeu pathologique et
recherche de sensations, explor�e par l��chelle de Zuckerman, se r�v�le
soit positive, soit n�gative�
Si
une diff�rence se confirmait quant aux r�sultats au S.S.S entre le jeu
pathologique et d�autres formes d�addictions, l�instrument lui-m�me
devrait �tre interrog� : faudrait-il par exemple imaginer une diff�rence
importante de probl�matique entre prise de risque, et recherche de
sensations ?
Retour
en haut de la page
�tudes
psychobiologiques
Les
recherches actuelles se font dans le domaine o� les scientifiques ont
fait le plus de progr�s, le champ de la neuropharmacologie, des
neurotransmetteurs.
Mais l�exemple de la d�pression, comme celui de la psychopathie (ou du
caract�re antisocial), montrent la difficult� � isoler des facteurs sp�cifiques
du jeu pathologique : cliniquement, nous avons vu qu�il est souvent
difficile de savoir si la d�pression a pr�c�d� le jeu, qui a alors
valeur de tentative d�autom�dication, ou si elle en est une simple cons�quence.
Et les m�mes questions vont se poser en ce qui concerne les conduites de
d�linquance, l�usage associ� de drogues, de tabac, d�alcool, etc�
Les r�sultats de recherches biologiques visant � isoler des �causes�
physiologiques du jeu pathologique sont donc � aborder avec beaucoup de
prudence.
Hickey,
Haertzen et Henningfield ont �tudi� en 1986 chez 19 volontaires ayant
des ant�c�dents de jeu compulsif les sensations procur�es par la
simulation du gain au jeu, et ont montr� qu�elle g�n�rait une
euphorie comparable � celle de drogues fortement toxicomanog�nes; effets
euphorisants tout particuli�rement comparables � ceux des drogues
psychostimulantes. Ce qui, soulignent les auteurs, est en accord avec les
observations se rapportant au jeu en tant qu��quivalent comportemental
de l�usage de psychoanaleptiques.
Selon
certains auteurs, un dysfonctionnement du syst�me nor-ad�nergique
central serait � envisager comme pr�existant.
Les chercheurs aimeraient, en effet, pour l�ensemble des addictions,
trouver des perturbations communes qui seraient origine, et non cons�quence,
de ces conduites.
Les perturbations des m�canismes des endorphines sont aussi �voqu�s,
mais, l� aussi, les r�sultats ne sont gu�re concordants. Il semble de
plus que l�h�t�rog�n�it� du groupe �joueurs pathologiques�,
soit une cause de discordance des r�sultats (Blasczynski)�
Retour
en haut de la page
Addictions
et hypoth�se ordalique
La
notion de conduites ordaliques ( M. Valleur, A.J. Charles-Nicolas),
pourrait �tre un �l�ment central d'�clairage des aspects actifs,
paradoxaux, des addictions.
Notre
interrogation sur le versant ordalique des toxicomanies s�inscrit dans
la suite de la d�marche de C. Olievenstein, qui, depuis le d�but des ann�es
70, tente d��laborer une clinique des toxicomanies, en
s�interrogeant, de fa�on plus descriptive et ph�nom�nologique, que
psychanalytique, sur la relation du toxicomane au plaisir, au temps, � la
mort�
La
notion de conduites ordaliques, introduite d�s 1981 , s�inscrit
dans ce cadre de r�flexion, et correspond � une id�e simple : la prise
de risques peut, � certains moments et chez certains sujets, �tre
activement recherch�e, � travers un v�cu d��preuve, voire de mort et
de r�surrection.
A
l'origine, l'introduction de cette notion avait essentiellement pour but
de nuancer une vision des toxicomanies comme conduites autodestructrices.
Celles-ci sont encore souvent interpr�t�es au plan individuel comme un �quivalent
suicidaire , et nombre d'auteurs, implicitement, en
font un �quivalent de suicide m�lancolique, recourant � une m�taphore
maniaco-d�pressive de la toxicomanie, sans doute inaugur�e par S. Rado,
et poursuivie dans une optique kleinienne par H. Rosenfeld.
Dans cette optique, la toxicomanie est donc l'�quivalent d'un suicide, et
au plan collectif elle peut correspondre � une attitude
sacrificielle d'une partie de la jeunesse.
Pour nuancer cette vision suicidaire
sacrificielle des toxicomanies, nous avons donc �t� amen�s �
mettre en avant la fonction positive de la prise de risque, ph�nom�nologiquement
distincte d'un comportement autodestructeur...
Rappelons
que l�ordalie est le terme qui d�signe le jugement de Dieu, mode de
preuve universel dans le droit antique. Dans les formes les plus anciennes
et les plus pures d�ordalies, le sujet soup�onn� de sorcellerie ou de
crime est expos� � une �preuve par �l�ments naturels (poison, fer
rouge, eau, etc.), et la mort est � la fois verdict et application de la
peine.
La conduite ordalique d�signe le fait pour un sujet, de s'engager de fa�on
plus ou moins r�p�titive dans des �preuves comportant un risque mortel
: �preuve dont l'issue ne doit pas �tre �videmment pr�visible, et qui
se distingue tant du suicide pur et simple, que du simulacre.
Le
fantasme ordalique, sous-tendant ces conduites, serait le fait de s'en
remettre � l'Autre, au hasard, au destin, � la chance, pour le ma�triser
ou en �tre l'�lu, et, par sa survie, prouver tout son droit � la vie,
sinon son caract�re exceptionnel, peut-�tre son immortalit�...
La
conduite ordalique est donc en quelque sorte toujours � deux faces :
d�un c�t�, abandon ou soumission au verdict du destin, de l�autre
croyance en la chance, et tentative de ma�trise, de reprise du contr�le
sur sa vie.
Tentative,
pour un sujet d�pendant, ayant � perdu
le contr�le de sa vie �(selon la formulation A/A-N/A), de
reprendre en main son destin, elles constitueraient l'envers
de la d�pendance. Le jeu avec la mort serait donc bien d�marche
magique, irrationnelle, de passage et de renaissance, et non
autodestruction de sujets d�sesp�r�s.
La dimension transgressive est ici centrale, si l�on admet que la
transgression est aussi recherche de sens, de l�gitimation de la Loi.
Nous nous situons donc bien � l�interface entre l�individuel et le
collectif, entre le sujet et le contexte socioculturel.
Nous
proposons donc l'hypoth�se que les diff�rentes formes de d�pendances,
les diverses � addictions �, se distribueraient suivant un
continuum, des d�pendances les plus accept�es ou les plus passives, aux
plus � ordaliques �: A une extr�mit� le tabagisme, voire
les troubles des conduites alimentaires, � l'autre les formes actuelles
de toxicomanies, avec leur versant de marginalit� parfois recherch�e, de
r�volte souvent manifeste, de transgression toujours pr�sente.
Dans
cette classification des addictions, le jeu "pathologique"
devrait occuper un position centrale:
Socialement
� l�galis� �, tol�r� sous diverses formes, voire
encourag� par l��tat, le jeu ne devrait pas entra�ner la moindre
marginalisation, ou stigmatisation de ses adeptes. Or, voie courte,
quasi-mystique ou magique vers la fortune, il garde en soi, dans les repr�sentations
du public comme des joueurs eux-m�mes, l'aura de r�probation morale qui
vise la facilit�, le refus de l'effort, de la voie longue...
Subjectivement,
comme A. Ivanovitch, le h�ros de Dosto�evski, c'est bien sa vie que le
joueur mise, m�me s'il le fait par le moyen indirect de l'argent. Et la
question de savoir si l'on joue pour gagner, ou pour perdre de fa�on
masochiste, ne peut s'aborder que dans l'optique d'une �preuve ordalique,
sans cesse re�commenc�e. La sensation extr�me, le � thrill �,
tient en fait � cette situation de jugement, o� le sujet attend le
verdict du destin, du hasard, de la chance...
C'est,
comme dans la prise de risque mortelle, la personnification du hasard,
l'affrontement direct au Dieu de l'ordalie, qui cr�e la possibilit� de
la rencontre, de la fortune (tuch), sinon du traumatisme et de la r�p�tition:
Dr
Marc Valleur
Psychiatre-addictologue
Chef
de Service
Centre
m�dical Marmottan
17/19
rue d'Armaill�
75017
Paris
Retour
en haut de la page |