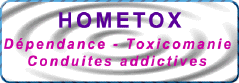|
La
toxicomanie aux opiac�s (produits naturels ou synth�tiques d�riv�s du
pavot), est une caract�ristique europ�enne. leurs sp�cificit�s, les
effets peuvent en partie expliquer la pr�pond�rance de l'h�ro�nomanie
en comparaison avec la coca�ne ou les produits de synth�se.
Afin
de mieux comprendre leur propri�t�s il faut d'abord faire un rappel sur
la douleur et les mol�cules qui interviennent dans la perception
algog�ne.
DOULEUR
le
r�le et la place de la douleur dans l��tude des opiac�s semblent �vident.
La douleur physique et la douleur morale sont souvent incrimin�s dans les
rechutes de ces patients. Le r�le des opiac�s dans la douleur est codifi�,
ce qui permet une meilleure �tude.
Selon l�IASP (Association
Internationale d��tude de la douleur), la douleur est d�finie
comme : � ..une exp�rience
sensorielle et �motionnelle d�sagr�able li�e � une l�sion tissulaire
existante ou potentielle ou d�crite en terme d�une telle l�sion �.
ll faut se rappeler plusieurs dimensions de la douleur :
 Les m�canismes
pathologiques qui la g�n�rent ou l�entretient : au niveau
somatique (l�exc�s de nociception, des troubles sympathiques ou
musculaires r�flexes) et au niveau psychologique (l�anxi�t�, la d�pression,
des troubles conversifs ou hypocondriaques) ; Les m�canismes
pathologiques qui la g�n�rent ou l�entretient : au niveau
somatique (l�exc�s de nociception, des troubles sympathiques ou
musculaires r�flexes) et au niveau psychologique (l�anxi�t�, la d�pression,
des troubles conversifs ou hypocondriaques) ;
 L�exp�rience
algique elle-m�me :
au niveau physique (les r�actions
neurov�g�tatives � cardio-respiratoires, sudorales � et motrices
� agitation, attitude antalgique, plaintes somatiques) et au niveau
psychologique (la sensation per�ue, l��motion d�sagr�able
concomitante).
L�exp�rience
algique elle-m�me :
au niveau physique (les r�actions
neurov�g�tatives � cardio-respiratoires, sudorales � et motrices
� agitation, attitude antalgique, plaintes somatiques) et au niveau
psychologique (la sensation per�ue, l��motion d�sagr�able
concomitante).
Le
concept de douleur aigu� d�finit
une douleur d�installation r�cente, qui alerte le patient sur
l�existence d�un traumatisme, d�une l�sion ou d�une pathologie en
cours d�installation ; c�est donc un sympt�me utile qui permet
au sujet de garder son int�grit� physique en l�incitant � se prot�ger
et � s�extraire de l�influence d�un stimulus externe nocif.
La douleur chronique caract�rise
des douleurs persistant depuis au
moins 3 � 6 mois. La douleur chronique peut �tre en relation avec
une maladie �volutive, les s�quelles d�une maladie ou d�un
traumatisme, une pathologie psychologique. Cette douleur chronique induit
peu � peu un retentissement sur les capacit�s physiques et l��quilibre
psychologique et social du patient.
Le sch�ma classique et simplifi� de la transmission des informations est
le suivant : des stimuli de plusieurs types, des r�cepteurs sp�cialis�s
Les
PALIERS de l�O.M.S.
L�O.M.S.
a propos� de classer les antalgiques en trois paliers ou niveaux. Cette
�chelle permet une hi�rarchie des analg�siques en fonction de leur
niveau de puissance et de leurs rapports avantages/inconv�nients. M�me
si cette �chelle a �t� �labor�e dans le cadre de la prise en charge
des douleurs d�origine canc�reuse, elle permet � tout praticien de se
r�f�rer � une classification op�rationnelle d�s lors qu�il doit
traiter une douleur sur le plan symptomatique. Cette �chelle se d�finit
ainsi :
Niveau
1
: Analg�siques non morphiniques, appel�s aussi, � tort, analg�siques p�riph�riques
ou mineurs. Ils sont repr�sent�s par le parac�tamol, l�aspirine et
les anti-inflammatoires non st�ro�diens (A.I.N.S.).
Niveau
2
: Agonistes morphiniques faibles. Le niveau 2 est constitu� par des
associations entre analg�siques de niveau 1 et analg�siques morphiniques
faibles : dextropropoxyph�ne et
cod�ine.
Cod�ine
- Alcalo�de de l'opium, est �galement utilis�e comme antitussif et
antidiarrh�ique. Son effet antalgique est 5 � 10 fois plus faible que
celui de la morphine et sa dur�e d'action est d'environ 5 heures. L'effet
d�presseur respiratoire est faible et utilis�e aux doses th�rapeutiques,
la Cod�ine est assez peu toxicomanog�ne. Son absorption digestive est
rapide, le m�tabolisme est h�patique (l'action antalgique de la cod�ine
serait d� � sa transformation en morphine au niveau du foie), l'�limination
urinaire. La cod�ine traverse le placenta et passe dans le lait maternel.
Les pr�sentations de la cod�ine
sont vari�es. Elle peut �tre utilis�e seule sous la forme d'un d�riv�
: la dihydrocod�ine, Dicodin, d'une dur�e d'action plus longue (environ
12 heures). Son association au parac�tamol est synergique (Codoliprane,
Efferalgan
cod�in�) et s'utilise � la dose de 1 � 2 comprim�s 1 � 3 fois par
jour. Les effets ind�sirables les plus fr�quents sont la constipation,
les naus�es et la somnolence. Plus rarement: allergies, bronchospasme, d�pression
respiratoire. Les risques de d�pendance et de sevrage � l'arr�t du
traitement ne se voient pas aux doses th�rapeutiques. Le surdosage r�alise
un tableau d'intoxication morphinique (troubles de la conscience, d�pression
respiratoire, myosis, risque de bronchospasme et de laryngospasme)
imposant un traitement en milieu sp�cialis� par r�animation
cardio-respiratoire, lavage gastrique, administration de naloxone et le
cas �ch�ant (association avec le parac�tamol), de N ac�tylcysteine.
Dextropropoxyph�ne, est un analg�sique opiac� d�rivant de la m�thadone ayant un effet
analg�sique inf�rieur � celui de la cod�ine. Il est consid�r� comme
peu toxicomanog�ne aux doses th�rapeutiques. Son absorption digestive
est rapide (action par voie orale en 1 h 30 pendant 4h), la m�tabolisation
est h�patique et l'�limination urinaire. La demi-vie d'�limination est
de 8 � 10 heures. Les pr�sentations du dextropropoxyph�ne sont vari�es.
Il peut �tre employ� seul (Antalvic
: 1 comprim� 3 fois par jour jusqu'� 6 comprim�s) ou associ� au parac�tamol
(Di-antalvic), substances potentialisant l'effet analg�sique. Les effets ind�sirables
sont le plus souvent digestifs. Certaines manifestations imposent l'arr�t
imm�diat du traitement : r�actions cutan�es allergiques, hypoglyc�mies,
h�patites cholestatiques, confusions. Le surdosage survient pour des
doses importantes de l'ordre de plusieurs grammes et r�alise un tableau
d'intoxication morphinique (troubles de la conscience, d�pression
respiratoire, myosis...) imposant un traitement en milieu sp�cialis� par
r�animation cardio-respiratoire, lavage gastrique, administration de
Naloxone.
Niveau
3
: Regroupement des agonistes morphiniques forts (morphine, p�thidine,
dextromoramide) et des agonistes antagonistes (pentazocine et nalbuphine).
On distingue le niveau 3a quand les agonistes morphiniques forts
sont administr�s par voie orale et le niveau 3b quand ils le sont par
voie parent�rale ou centrale.
Ce
sont les antalgiques les plus puissants. On les utilise dans les douleurs
s�v�res et dans les douleurs d'origine canc�reuse. Il faut savoir
manier ces produits et
surtout, les utiliser au bon moment. Les antalgiques morphiniques doivent
leurs propri�t�s � la mise en jeu de cinq types de r�cepteurs
morphiniques : mu, delta, eta, sigma et kappa. La pluralit� fonctionnelle
de ces r�cepteurs et la disparit� des interactions entre les diff�rents
opiac�s et les r�cepteurs font qu'on distingue 3 cat�gories de produit
: les agonistes purs (complets
ou partiels), les agonistes mixtes
ou agonistes-antagonistes et les
antagonistes purs. La notion
d'activit� intrins�que de la mol�cule (dont d�pend l'amplitude de
l'effet maximal) d�finit encore mieux ces cat�gories : Pour les
agonistes purs, cette activit� est de 1. Elle est comprise entre 0 et 1
pour les agonistes partiels, �gale � 0 pour les antagonistes. Le plus
connu des agonistes purs c�est la morphine (voire plus bas).
On
va �num�rer sans pr�tention les morphinomim�tiques les plus connus :
Autres
agonistes purs complets :
La p�thidine,
Dolosal,
a un effet antalgique un peu moins puissant que celui de la morphine et sa
dur�e d'action est plus courte. C'est le seul morphinique qui poss�de
des propri�t�s spasmolytiques.
Le dextromoramide,
Palfium,
a un effet plus puissant que celui de la morphine mais sa courte dur�e
d'action ne permet pas son utilisation dans le traitement des douleurs
chroniques.
Le fentanyl,
Fentanyl,
est un morphinomim�tique tr�s puissant (analg�sie chirurgicale 50 �
100 fois sup�rieur � celle de la morphine) r�serv� � l'anesth�sie
(tr�s utilis� dans les anesth�sies pr�-hospitali�res).
Agonistes
partiels et agonistes-anatgonsites :
A
l'inverse de la morphine, ils exposent � l'effet plafond (� partir d'un
seuil, l'analg�sie n'augmente plus avec l'augmentation des doses) et
l'administration d'agonistes-antagonistes (encore appel�s agonistes
mixtes) peut provoquer un syndrome de sevrage chez des patients pr�alablement
trait�s par morphine.
Bupr�norphine,
T�mg�sic
ou Subutex,
est plus puissante que la morphine mais son efficacit� th�rapeutique est
moindre en raison du caract�re partiel de l'agonisme � . Cependant la
liaison de la bupr�norphine aux r�cepteurs � est si forte que la
naloxone, en cas de surdosage, est peu efficace.
La
pentazocine (Fortal)
et la nalbuphine (Nubain)
sont des agonistes-antagonistes. Ils sont agonistes des r�cepteurs kappa
et antagonistes des r�cepteurs mu. Ces propri�t�s pharmacologiques
imposent donc de respecter un intervalle libre entre l'administration de
ces produits et celle des agonistes complets afin d'�viter tout ph�nom�ne
de comp�tition. L'association avec des agonistes complets est illogique
et � proscrire.
En
terme de strat�gie th�rapeutique, la potentialit� de chacun de ces
paliers de puissance progressive sera exploit�e au maximum et le passage
d�un palier � l�autre se fera en fonction de l��volution de la
douleur et du degr� de soulagement du malade. On veillera en particulier,
avant de changer de niveau, � ce que la posologie soit adapt�e et que
les co-analg�siques �ventuellement n�cessaires aient �t� prescrits.
On s�assurera du respect des intervalles entre les prises, de la prise
en charge optimale relationnelle et psychologique du malade et d�une
bonne compliance au traitement. L'association d'antalgiques de m�me
niveau ne se justifie pas.
Les opiac�s - naturels
comme la morphine, synth�tiques comme l�h�ro�ne ou endog�nes
agissent sur des structures membranaires sp�cifiques, les r�cepteurs op�odes.
On a individualis� cinq types : mu, delta, eta, sigma et kappa. Ces r�cepteurs
sont localis�s au niveau de structures anatomiques spinales et supra
spinales impliqu�es dans le contr�le du message nociceptif : corne post�rieure
de la moelle, tronc c�r�bral, thalamus et syst�me limbique. Les r�cepteurs
� semblent les plus impliqu�s dans la gen�se de l'analg�sie. Les opio�ds
� mineurs ou majeurs � se fixent sur ces r�cepteurs membranaires,
aboutissent � une inhibition de la lib�ration de la substance P qui est
impliqu�e dans la transmission de l'influx nociceptif. Par ailleurs, un
certain effet psychotrope propre aux opio�ds (euphorie, prise de distance
par rapport � l'algog�ne) contribue � l'effet antalgique.
Le
corps humain fabrique des substances naturelles d�couvertes en 1975 : les
enk�phalines et endorphines. Ces substances jouent un r�le important
dans la transmission des sensations douloureuses et dans leur contr�le
naturel. Il semblerait que l'absorption massive de produit morphinique
tels que l'h�ro�ne et la morphine bloque la fabrication naturelle de ces
substances endog�nes, remplac�es alors par des produits exog�nes.
L'arr�t
brutal de prise de drogue provoquerait une d�pression de ce syst�me enk�phaline-endorphine
et les troubles du manque appara�traient alors accompagn�s de sueurs,
douleurs aigu�s, contractures musculaires, hallucinations et anxi�t�
dus au d�r�glement de la production naturelle de ces produits c�r�braux.
|